Table des matières
- ![]() Précédente - Suivante
Précédente - Suivante![]()
Les conséquences de l'érosion en aval: les nuisances
A l'amont, l'érosion touche des individus: elle est souvent perçue comme une fatalité. A l'aval, les nuisances dérangent des collectivités qui ont accès à la place publique, à la presse et organisent des débats pour dénoncer les coupables.
L'érosion a, somme toute, des influences négatives très variables sur les rendements (nulles à fortes) et sur le potentiel de production des terres. Mais le coût des nuisances à l'aval des champs érodés est généralement bien plus élevé, les effets sont bien plus spectaculaires, et justifient la plupart des interventions importantes dans le domaine de la lutte antiérosive.
C'est le cas de la RTM qui vise le maintien des voies de communication en montagne et la protection des vallées aménagées. C'est le cas de la DRS dont l'objectif est de protéger les terres, mais surtout d'éviter l'envasement trop rapide des barrages, la destruction d'ouvrages d'art, des routes et des villages.
Même la CES, qui officiellement, vise à maintenir la capacité de production des terres, en réalité, vise aussi la protection de la qualité des eaux, si indispensable aux citadins. Cela justifie les efforts considérables de l'Etat pour aider techniquement et financièrement les paysans (plus ou moins volontaires selon les régions) à aménager leurs terres. Rappelons qu'aux Etats-Unis, près de 50 % des chercheurs du service de conservation de l'eau et des sols, s'occupent de la qualité des eaux et des pollutions diverses, plutôt que de la protection des terres.
Les nuisances à l'aval, c'est d'abord la baisse de la qualité des eaux des rivières par les matières en suspension (MES) qui accompagnent les crues formées en majorité par le ruissellement. Avec la charge en suspension, circulent les charges organiques (danger pour l'oxygène nécessaire à la faune) liées par exemple à l'élevage intensif (lisier). Les apports d'azote et de phosphore (engrais minéraux utilisés par des paysans) qui vont entraîner l'eutrophisation des étangs (envahissement par les algues, qui à leur tour, vont asphyxier les poissons). Si le ruissellement abondant à certaines périodes de l'année entraîne l'augmentation des débits de pointe dans les exutoires, il aboutit également à réduire l'alimentation des nappes et les débits d'étiage. D'une part, il provoque dans la vallée la reprise de matériaux sédimentés sur le fond et les berges: cette reprise d'érosion au niveau des petites rivières s'observe très souvent en Afrique. D'autre part, en saison sèche, le faible débit d'étiage n'arrive plus à évacuer les polluants secrétés par les industries, les villes et les cultures intensives: d'où l'eutrophisation des rivières et la mort de dizaines de tonnes de poissons chaque année en Europe. Les nuisances proviennent aussi des transports solides liés aux grandes crues qui laissent des torrents de boue au bas des champs, dans les fossés, sur les routes, dans les caves. Une fois le débit de pointe passé, des masses considérables de sédiments se déposent dans les lacs, les fleuves, les canaux et les ports.
C'est ainsi que la durée de vie des barrages, élément essentiel de leur rentabilité économique, varie considérablement d'une région à une autre, et dans une même région, en fonction des dimensions respectives du réservoir et du bassin, mais aussi du climat et de la couverture végétale, de l'aménagement des versants, des ravines et des berges des rivières.
Alors que le barrage de Kossou, construit dans les savanes arborées du centre de la Côte d'Ivoire, ne risque pas d'être envasé avant un millénaire, les principaux réservoirs du Maghreb ont une durée de vie très courte (25 à 60 ans) et les lacs collinaires (petits réservoirs, très près des sources de sédiments) ont des durées de vie limitées souvent à moins de 2 à 10 ans.
Quand on sait le prix du moindre barrage, on comprend l'effort colossal mis en place pour réduire les transports solides en zone méditerranéenne où la lithologie est faite de masses argileuses, marneuses, de grès ou schistes tendres, alternant avec des bancs calcaires ou gréseux durs, associées à des pentes fortes et des couverts végétaux souvent fort dégradés par le surpâturage et les feux.
En Algérie, un effort louable a été entrepris depuis les années 1945 pour reforester les têtes de vallées (50.000 ha), les "badlands", fixer les ravines et corriger les oueds, aménager 300.000 ha de terres cultivées en banquettes d'absorption ou de diversion (construites par les services de DRS puis par la Direction Nationale des Forêts). Depuis 1978, la construction de banquettes a été suspendue, suite aux critiques des chercheurs, au rejet des paysans, et surtout, aux difficultés économiques. La lutte antiérosive a été restreinte à la protection des ouvrages d'art, à la reforestation, à la végétalisation des ravines et à la construction des grands barrages: il ne reste que la RTM en faveur de la qualité des eaux, des périmètres irrigués et des besoins des citadins des grandes villes. Pour les paysans, les seules actions de l'Etat concernent aujourd'hui l'amélioration foncière (c'est-à-dire, sous-solage des sols à croûte calcaire, qui augmente la productivité des céréales) et la création de petites retenues collinaires, fournissant de l'eau en tête de vallée pour le bétail, l'habitat et quelques hectares d'irrigation. Même cette politique est remise en cause par des hydrologues qui font remarquer que l'envasement des barrages n'a pas diminué depuis l'effort consenti par l'aménagement des hautes vallées. Les travaux de Heusch (1970 et 1982) et Demmak (1982) montrent que la majorité des sédiments piégés dans les réservoirs proviennent du ravinement, des glissements de terrain, des éboulements des berges et de la divagation des oueds. En fonction de la part des objectifs des projets de lutte antiérosive en vue de réduire les nuisances à l'aval ou de préserver le capital foncier des versants, on cherchera un compromis permettant d'intervenir dans les vallées pour piéger les sédiments et stabiliser les berges tout en aménageant les versants pour réduire et retarder le ruissellement (améliorations foncières, talus enherbés, techniques culturales pour couvrir le sol en hiver et revégétaliser les zones surpâturées). Des méthodes de calcul économique existent, qui permettent de choisir les interventions de lutte antiérosive les plus efficaces, en se basant sur les coûts des traitements antiérosifs, des nuisances auxquelles on peut s'attendre en l'absence d'intervention (voir les cours du CEMAGREF de Grenoble).
La rationalité économique de la GCES
Jusqu'ici, la lutte antiérosive était conçue comme un moyen d'assurer la conservation de la productivité des terres à long terme. Il était donc bien difficile de justifier la rentabilité à court terme des projets de lutte antiérosive. Face à l'immensité de la tâche, des sommes importantes (quelques milliards de dollars pour l'ensemble de la planète) ont été consacrées à des programmes de protection des terres. Cependant, leur efficacité a été faible à cause du type d'approche utilisée et de méthodes peu appropriées aux conditions socio-économiques du milieu. Les sommes disponibles étant limitées, il faut faire des choix en fonction des objectifs affichés. Il faut aujourd'hui chercher les méthodes les plus efficaces et les moins chères. Il est possible de raisonner sur ces choix des sites d'intervention en fonction des objectifs des projets. A la figure 12, apparaît une différence de réaction de deux types de sols, face à l'érosion. La courbe 3 montre la perte rapide de productivité d'un sol forestier, où la fertilité est localisée en surface. A la courbe 1, on observe que la perte de productivité d'un loess profond reste faible, même si l'érosion est forte, car le sol fertile est épais, et sa capacité à stocker l'eau et les nutriments n'est guère diminuée (sauf par la perte des matières organiques de surface).
La stratégie conventionnelle jusqu'ici appliquée par les forestiers et les aménagistes (RTM et DRS) consistait à intervenir là où les transports solides sont les plus élevés: sur les pentes fortes, dans les ravines, les zones décapées et les sols stériles épuisés. On constate que l'impact de cette lutte antiérosive est très faible sur la productivité des terres très dégradées 1 et 2 (dRT 1 et 2 sur la figure), d'où la réticence des paysans devant les équipements imposés, par exemple les banquettes, qui n'améliorent pas les rendements, et devant les restrictions mises au pâturage libre.
Pour obtenir une forte amélioration de la productivité des terres (dRT 3), ce n'est pas sur les terres épuisées, qu'il faut intervenir, ni sur les sols profonds (courbe 1), mais sur les sols à fertilité superficielle encore en bon état: la courbe 3 est beaucoup plus raide en cas de faible érosion que lorsque l'érosion est déjà forte et les sols trop dégradés. Cette approche est préconisée par la GCES, où l'amélioration modeste des systèmes de production permet un meilleur stockage des eaux pluviales, une plus forte production de biomasse, une meilleure couverture du sol et. Dar conséquent. beaucoup moins d'érosion.
FIGURE 12
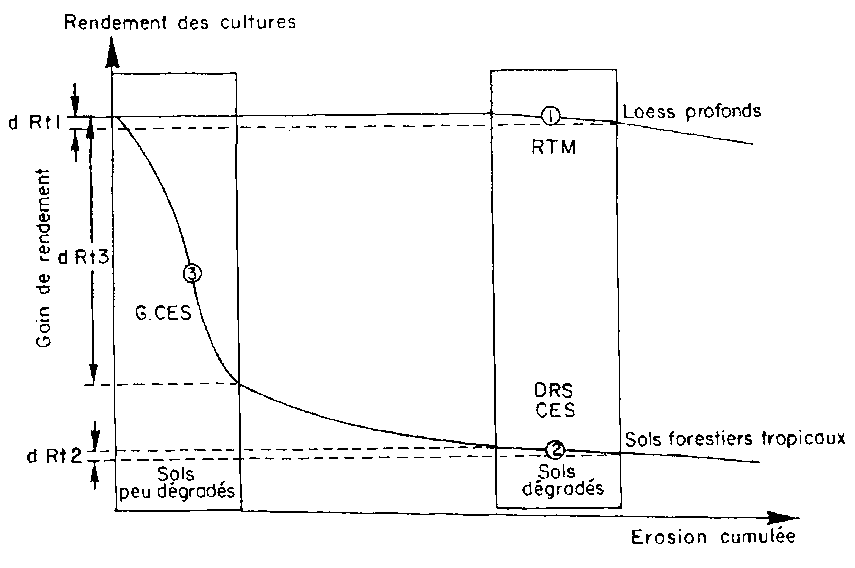
Intérêt des stratégies d'équipement rural (RTM - DRS - CES) et de développement rural (GCES) face aux situations pédologiques.
Si on veut rentabiliser au mieux les crédits consacrés à la protection des terres, il est logique d'investir sur les meilleures terres en production pour prévenir leur dégradation ou encore, restaurer la production des terres qui commencent juste à se dégrader, plutôt que d'investir dans des terres complètement décapées qui exigent un fort investissemment pour retrouver (à la longue) une productivité acceptable. Il est cependant des cas (Haïti) où les sommets des collines très décapées ("terres finies") sont la source d'un fort ruissellement qui peut détruire les sols fertiles des bas-versants. Il est alors nécessaire de végétaliser les sommets, de les mettre en défens et de capter les eaux de ruissellement dans des citernes pour l'irrigation d'appoint des sols profonds de bas de pente.
L'intervention conventionnelle sur les sols décapés entraîne rarement des effets positifs sur les rendements (dRt 1 et 2). Pour intéresser les paysans, il vaut mieux choisir des terres encore valables qui vont répondre rapidement et significativement aux nouveaux systèmes de production.
Cependant, d'un point de vue social, on ne peut abandonner toutes les terres dégradées peu rentables et provoquer un mouvement migratoire accéléré dont on connaît les problèmes. Par ailleurs, il existe des circonstances où les sols dégradés par l'érosion sont les seuls qui restent disponibles et sont susceptibles d'être restaurés avec de faibles moyens financiers. C'est le cas de certains zipellés du plateau Mossi qu'on peut actuellement récupérer en un an par la méthode du zaï (300 heures de travail de piochage + 3 tonnes de fumier et son transport (Roose, Dugue, Rodriguez, 1992).
CONSEQUENCES ECONOMIQUES DE L'EROSION
|
1. Pertes sur les lieux érodés (on elles concernent les paysans. |
• Pertes d'eau, d'engrais et pesticides;
|
• Perte de production immédiate au niveau |
régional : |
2 à 10 %: compensation possible par apport d'intrants |
|
local : |
2 à 50 % = catastrophe individuelle = perte de la marge bénéficiaie |
|
• Perte de surface cultivable au niveau |
mondial ... |
7 à 10 millions d'hectares par an |
|
régional ... |
2 à 5 % | |
|
parcelles ... |
jusque 20 à 100 % | |
|
Il faudrait 2 siècles pour détruire toutes les terres cultivables | ||
• Perte de productivité à long terme = MEMOIRE du SOL
Diminution de l'épaisseur de l'horizon humifère
Diminution du stockage d'eau et de nutriments
Diminution de l'efficacité de la pluie et des intrants
Diminution de la rentabilité = fatigue du sol
NOTION de DUREE de VIE des SOLS
|
2. Nuisances à l'aval (off-site): concernant les citadins. |
|
• Dégradation de la qualité des eaux |
pollution des rivières, mort des poissons envasement des réservoirs, dragage des ports |
|
• Augmentation des matières en suspension (MES) |
augmentation du prix de l'eau potable |
|
• Inondations des zones habitées |
coulées boueuses, fossés ensablés |
|
• Augmentation des débits de pointe des rivières |
destruction des ouvrages d'art, ponts, etc. |
|
3. Conséquences majeures pour la lutte antiérosive. |
|
L'érosion sur les sols |
profonds |
n'a d'effet que sur les nuisances à l'aval, peu sur les rendements |
|
superficiels |
a un effet rapide sur la dégradation des rendements. |
Choix d'une politique économique de LAE:
|
• RTM et DRS |
sur les terres dégradées améliorent peu les rendements mais réduisent les transports solides | |
|
• CES |
réduit les pertes en terre des champs, conserve les sols, mais n'améliore pas leur fertilité | |
|
• GCES |
- s'intéresse d'abord aux terres productives | |
|
- améliore les rendements |
en restaurant leur fertilité | |
|
en réduisant le ruissellement | ||
|
en augmentant la couverture végétale | ||
|
- réduit indirectement ou à long terme les débits de pointe et les transports solides des rivières. | ||
|
CONCLUSIONS |
• La dégradation des terres ne gène sérieusement que quelques petits propriétaires terriens.
• Les nuisances à l'aval coûtent bien plus cher et forcent l'Etat à réagir.
• Généralement on améliore le drainage (canaux en béton) pour réduire les nuisances.
• La GCES propose de s'attaquer à la cause et d'améliorer l'infiltration en modifiant les systèmes de production.
Par contre, si on cherche à limiter les transports solides et les risques d'envasement, ou encore si on vise des objectifs sociaux (donner du travail aux plus pauvres, dans les zones à forte émigration), c'est dans les zones les plus dégradées et les plus proches du lit de la rivière (correction de ravines, des berges et des torrents) qu'il faut intervenir.
|
En conclusion, il faut définir clairement les objectifs à atteindre avant de proposer des méthodes de lutte antiérosive. Si on cherche à réduire la dégradation des terres (logique amont, paysanne), il faut développer des techniques capables d'augmenter rapidement leur productivité (augmenter leur capacité d'infiltration, apporter des engrais, des semences sélectionnées, des soins phytosanitaires, etc...): les paysans trouveront rapidement un intérêt à participer à ces projets. Si par contre, on cherche à réduire les risques d'envasement (logique aval), l'intervention ne peut intéresser les paysans des hautes vallées que moyennant des incitations ou des compensations pour les surfaces de production perdues, les heures de travail, les inconvénients créés par les ouvrages (fossés, banquettes, etc...). Il ne faut pas trop compter sur ces paysans pour l'entretien de ces structures, toujours dangereuses en cas de débordements (ravinement). (Roose, 1991 ). En réalité, on est souvent amené à un compromis: arrêter rapidement les processus les plus actifs sur les terres dégradées et les ravines, intercepter le ruissellement sur les versants caillouteux décapés et par ailleurs, entamer une modification progressive des systèmes de culture sur les bonnes terres en voie de dégradation. |