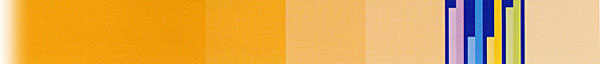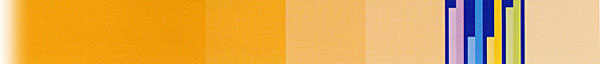
Le Sommet mondial de l'alimentation: cinq ans après est pratiquement pour demain. On y verra les gouvernants de ce monde réunis en Italie, comme ils l'ont fait en 1996 et en 1974. Que nous incombe-t-il de leur dire?
Durant les cinq années écoulées depuis l'adoption de la Déclaration de Rome et du Plan d'action du Sommet mondial de l'alimentation, quelques progrès ont été accomplis dans la lutte contre la sous-alimentation dans le monde en développement, tant en chiffres absolus - puisque l'on enregistre un déclin de près de 40 millions de personnes sous-alimentées, que comme proportion de l'ensemble de la population - puisque ce pourcentage est tombé de 20 à 17 pour cent.
Toutefois, comme le révèle la lecture des deux premiers articles de ce rapport et comme le confirment les tableaux de données (p. 51-54), les progrès sont loin d'être homogènes d'un pays à l'autre. En effet, alors que le nombre total des personnes sous-alimentées a décliné, on a vu leur nombre augmenter dans la majorité des pays. Comme ne manqueront pas de le souligner de nombreux lecteurs, l'attention ne devrait pas être centrée sur les indicateurs statistiques globaux; en effet, ce qui compte vraiment, ce sont les mesures adoptées en vue d'atténuer les pénuries alimentaires et la pauvreté dans chaque pays. En d'autres termes, si l'on prend pour hypothèse un seuil de 5 pour cent de personnes sous-alimentées dans une population, on voit que 93 des 125 pays en développement ou en phase de transition énumérés dans les tableaux de données peuvent être considérés comme présentant un problème de pénuries alimentaires.
Comment ce problème est-il perçu dans chacun des pays intéressés? Existe-t-il, à l'échelon national, une détermination manifeste de traiter le problème comme une question urgente? Peut-on savoir si les dirigeants nationaux prennent la situation au sérieux? En fait, certains indicateurs peuvent nous aider à apprécier la manière dont un pays fait face à l'insécurité alimentaire.
Commençons par les estimations de la FAO concernant le nombre de personnes sous-alimentées. Comment ces chiffres sont-ils perçus au niveau national? L'estimation est-elle considérée comme trop élevée et, si tel est le cas, pour quelle raison? Lorsque les pays proposent leurs propres chiffres, basés sur des observations plus directes, c'est là un phénomène utile et toujours encourageant, car il démontre qu'ils se sont attaqués au problème. C'est pourquoi il est hautement souhaitable que tous les pays fixent leurs propres objectifs, à l'échelon national, dans la perspective d'une réduction de moitié du nombre de personnes sous-alimentées pour 2015 au plus tard.
En second lieu, si les estimations de la FAO ou les autres estimations prises en considération sont plausibles, il reste à déterminer qui est sous-alimenté et à localiser ces personnes ou ces catégories dans le pays. Sait-on qui est pauvre ou affamé au sein de la population nationale? Connaît-on les paramètres relatifs aux conditions de vie, à l'environnement et aux risques particuliers qui caractérisent ces personnes, tels que la sécheresse ou la maladie? Sait-on, dans le pays, pourquoi ces groupes souffrent des pénuries alimentaires chroniques? Est-on disposé à élaborer un ensemble opérationnel de profils de vulnérabilité?
Enfin, quelles ressources met-on en œuvre pour s'attaquer non seulement aux symptômes, mais aussi aux causes profondes de la sous-alimentation et de la pauvreté? L'aide alimentaire est-elle disponible? Existe-t-il d'autres programmes offrant un filet de sécurité, notamment sous forme d'aide financière? A-t-on lancé des initiatives à long terme en matière de recherche et de développement afin d'intensifier et de rendre plus durable la productivité des ressources naturelles? Existe-t-il des programmes éducatifs visant à améliorer les pratiques sanitaires? Ces investissements sont-ils suffisants pour résoudre les problèmes affrontés? Sinon, quelles ressources supplémentaires peut-on mobiliser, si tant est que le pays se préoccupe de les mobiliser? Comment les communautés locales peuvent-elles contribuer à combler le «déficit des ressources» et, enfin, le gouvernement - et la communauté internationale - appuient-ils leurs efforts?
Toutes ces questions ont un même objet: évaluer la détermination d'un pays à surmonter la faim et les privations. Certes, les mesures qu'il convient de prendre à l'échelon national dépendent des circonstances propres à un pays. Comme on l'a dit au cours des dernières années, la panacée n'existe pas. Les exemples de «mesures d'intervention» cités dans ce numéro de L'état de l'insécurité alimentaire dans le monde couvrent tout un éventail d'actions susceptibles de donner des résultats concrets, et qui illustrent également tout ce qui peut être réalisé, à condition qu'existent la volonté politique et les ressources nécessaires. Ces mesures montrent également que l'élimination de la faim n'est pas seulement un impératif moral, mais qu'elle se justifie également au plan économique, puisqu'elle contribue à augmenter la productivité et les revenus, à créer des emplois et à promouvoir la demande de biens et services dans l'ensemble de l'économie.
La FAO reste convaincue que l'objectif visant à réduire de moitié le nombre des personnes sous-alimentées dans le monde, pour 2015 au plus tard peut être atteint, à condition que les pays et leurs partenaires de développement en fassent leur objectif. Cependant, il apparaît aujourd'hui clairement que l'on n'a pas su assigner en temps opportun, et là où le besoin existe vraiment, les ressources nécessaires à l'accomplissement de cette tâche. Dans certains cas, cela tient au fait que les pays sont en proie à la guerre civile, qui augmente de façon dramatique le nombre des personnes affamées tout en réduisant l'assistance au strict minimum. Dans d'autres cas, ce sont les partenaires extérieurs qui ont ménagé leurs efforts, à cause de la corruption et de la mauvaise utilisation des ressources qui caractérisaient, par le passé, les pays bénéficiaires. Cependant, tous ces facteurs n'expliquent pas de façon exhaustive l'insuffisance des réponses apportées. La FAO espère que le Sommet mondial de l'alimentation: cinq ans après permettra à tous ses partenaires de renouveler leur engagement à surmonter la faim et la pauvreté et à donner une signification concrète à leur engagement, en augmentant le flux de ressources consacrées à cet objectif.
Anthropométrie
Utilisation des mesures du corps humain pour obtenir des informations sur l'état nutritionnel.
Apport énergétique alimentaire
Quantité d'énergie fournie par la nourriture consommée.
Besoins énergétiques alimentaires
Quantité d'énergie alimentaire nécessaire pour entretenir les fonctions vitales, être en bonne santé et avoir une activité normale.
Besoins énergétiques alimentaires minimaux
Dans une classe d'âge et de sexe donnée, quantité d'énergie alimentaire par personne jugée suffisante pour mener une activité légère et être en bonne santé. À l'échelle d'une population, les besoins énergétiques minimaux sont la moyenne pondérée des besoins énergétiques minimaux des différentes catégories d'âge et de sexe. Ils sont exprimés en kilocalories par personne et par jour.
Circonférence du bras
Mesure de la circonférence du bras à mi-chemin entre le coude et l'épaule, au moyen d'un ruban gradué; c'est une mesure qui donne des indications indirectes sur deux composantes importantes du corps : la masse grasse et la masse maigre (ces composantes sont importantes car la masse grasse est la principale forme de stockage des graisses, tandis que la masse maigre, c'est-à-dire généralement le muscle, est un bon indicateur des réserves de protéines).
Coefficient de Gini
Indicateur global de l'inégalité des revenus, qui peut être compris entre 0 (égalité parfaite) et 1 (inégalité parfaite). Plus le coefficient est élevé, plus la distribution des revenus est inégale et vice-versa.
Déficit énergétique alimentaire
Différence entre l'apport énergétique alimentaire moyen d'une population sous-alimentée et ses besoins énergétiques minimaux moyens.
Degré de pénurie alimentaire
Indicateur de l'insécurité alimentaire globale dans un pays, combinant la prévalence de la sous-alimentation, c'est-à-dire la proportion de la population totale qui souffre de déficit énergétique alimentaire, et la gravité de la sous-alimentation, c'est-à-dire l'ampleur du déficit énergétique alimentaire de la population sous-alimentée.
Dénutrition
Résultat d'une sous-alimentation ou d'une mauvaise assimilation de la nourriture consommée.
Dépérissement
Poids insuffisant par rapport à la taille, résultant en général d'une perte de poids associée à une période de disette ou à une maladie récente.
Disponibilité énergétique alimentaire
Quantité de nourriture disponible pour la consommation humaine, exprimée en kilocalories par personne et par jour (kcal/personne/jour). À l'échelon d'un pays, on la calcule en déduisant de la production agricole tous les emplois autres que la consommation alimentaire (exportations, alimentation des animaux, transformation industrielle, semences et pertes).
État nutritionnel
État physiologique d'un individu résultant des interactions entre la ration alimentaire et les besoins, ainsi que de la capacité d'assimilation des nutriments.
Groupe vulnérable
Groupe de personnes présentant des caractéristiques communes et dont une forte proportion est exposée à l'insécurité alimentaire ou souffre de sous-alimentation.
Indice de masse corporelle (IMC)
Rapport entre le poids et la taille souvent employé pour estimer la proportion de graisse dans le corps. L'IMC est égal au poids (en kilogrammes)divisé par le carré de la taille (en mètres).Il n'est pas adapté à l'analyse des enfants en période de croissance, des personnes âgées émaciées et sédentaires ou des femmes enceintes ou allaitantes.
Insécurité alimentaire
Situation caractérisée par le fait que la population n'a pas accès à une quantité suffisante d'aliments sans danger et nutritifs pour avoir une croissance et un développement normaux, être en bonne santé et mener une vie active. L'insécurité alimentaire peut être due à l'insuffisance de la disponibilité alimentaire, à l'insuffisance du pouvoir d'achat, à des problèmes de distribution ou à l'inadéquation de la consommation alimentaire à l'échelon des familles. L'insécurité alimentaire, les mauvaises conditions d'hygiène et d'assainissement et l'inadaptation des pratiques de soin et d'alimentation sont les principales causes de problèmes nutritionnels. L'insécurité alimentaire peut être chronique, saisonnière ou temporaire.
Insuffisance pondérale
Poids insuffisant par rapport à l'âge chez les enfants et IMC inférieur à 18,5 chez les adultes, phénomène s'expliquant par un apport alimentaire insuffisant, des épisodes antérieurs de sous-alimentation ou un mauvais état de santé.
Insuffisance pondérale à la naissance
Poids à la naissance inférieur à 2 500 g.
Kilocalorie (kcal)
Unité de mesure de l'énergie. Une kilocalorie vaut 1 000 calories. Dans le système d'unités international, l'unité d'énergie universelle est le joule (J). Une kilocalorie vaut 4,184 kilojoules (kJ).
Macronutriments
Dans le présent rapport, on désigne par le mot macronutriments les protides, glucides et lipides dont le corps a besoin en grande quantité et qui peuvent être transformés en énergie. Ils sont mesurés en grammes.
Malnutrition
État physiologique anormal causé par des carences, des excès et des déséquilibres de l'alimentation (énergie, protéines et/ou autres nutriments).
Micronutriments
Vitamines, minéraux et autres substances dont l'organisme a besoin en petite quantité. Mesurés en milligrammes ou microgrammes.
Multiplication végétative
Matériel de multiplication végétale, à l'exclusion de semences véritables d'origine végétale, produisant des plantes cultivées génétiquement identiques.
Parité de pouvoir d'achat avec le dollar
Pouvoir d'achat d'une monnaie nationale par rapport au dollar des États-Unis, qui s'exprime par le nombre d'unités de cette monnaie requises pour acheter un panier de biens et services coûtant 1 dollar EU aux États-Unis.
Retard de croissance
Taille insuffisante par rapport à l'âge, phénomène s'expliquant par un épisode prolongé ou plusieurs épisodes de sous-alimentation dans le passé.
Sécurité alimentaire
Situation caractérisée par le fait que toute la population a en tout temps un accès matériel et socioéconomique garanti à des aliments sans danger et nutritifs en quantité suffisante pour couvrir ses besoins physiologiques, répondant à ses préférences alimentaires, et lui permettant de mener une vie active et d'être en bonne santé.
Systèmes de surveillance nutritionnelle
Les systèmes de surveillance nutritionnelle sont des systèmes de collecte des données qui recueillent, analysent, interprètent et diffusent, de façon systématique et permanente, des données sur la situation alimentaire et nutritionnelle, c'est-à-dire les indicateurs anthropométriques employés pour planifier, mettre en œuvre et évaluer les programmes nutritionnels.
Sous-alimentation
Ration alimentaire en permanence insuffisante pour couvrir les besoins énergétiques alimentaires.
Suivi de la croissance
Le suivi de la croissance est un aspect de la surveillance nutritionnelle. On prend régulièrement des mesures anthropométriques (poids, taille, circonférence du bras, etc.) pour suivre la croissance d'un enfant, en général au moyen d'un graphique. Les mesures anthropométriques permettent de calculer les indicateurs de croissance tels que l'insuffisance de la taille pour l'âge, l'insuffisance du poids pour la taille et l'insuffisance du poids pour l'âge, couramment employés pour les enfants, et l'indice de masse corporelle (IMC), de plus en plus employé pour les adultes.
Suralimentation
Ration alimentaire qui dépasse en permanence les besoins énergétiques alimentaires.
Surcharge pondérale et obésité
Masse corporelle supérieure à la normale en raison d'une accumulation excessive de graisses. Indique généralement une suralimentation. Dans le présent document, on considère qu'il y a surcharge pondérale lorsque l'IMC est compris entre 25 et 30 et obésité lorsqu'il est supérieur à 30.
Vulnérabilité
Existence de facteurs qui exposent l'individu à l'insécurité alimentaire ou à la sous-alimentation ou qui l'empêchent de faire face à ces situations.