Pourquoi un relevé d'emplacement est-il
indispensable?
En quoi consiste un relevé d'emplacement?
Quelles sortes d'instruments faut-il employer
pour mener a bien un relevé?
Mise
en train du relevé
Un relevé d'emplacement consiste à «geler» un paysage sous forme de carte, comparable à la photographie obtenue au moyen d'un appareil photographique. Toutefois, à la différence de la photographie, le relevé fournit beaucoup plus de données que ne pourrait en enregistrer l'œil.
Pourquoi un relevé d'emplacement est-il indispensable?
Dans le passé, beaucoup d'abris artisanaux ont été construits dans des emplacements appropriés sans que l'on accorde une attention particulière à des facteurs environnementaux tels que la hauteur des vagues, la présence de récifs non portés sur les cartes, les courants, les algues ou l'amoncellement de sable.
Toutefois, bon nombre des problèmes mineurs causés par ces facteurs se sont maintenant transformés en problèmes majeurs. Ainsi, certains abris ont été envahis par les algues parce que l'entrée de l'abri était orientée dans la mauvaise direction. D'autres se sont envasés car ils étaient édifiés directement sur une plage, ou bien ils sont simplement devenus inaccessibles par mauvais temps, les récifs étant trop proches de la passe d'entrée.
En conséquence, il est indispensable d'effectuer un relevé complet d'emplacement si on souhaite que l'abri ou le débarcadère puisse remplir sa fonction sans occasionner de problèmes de maintenance dans des conditions normales d'utilisation.
En quoi consiste un relevé d'emplacement?
Un relevé d'emplacement bien fait consiste à élaborer les documents suivants:
Quelles sortes d'instruments faut-il employer pour mener a bien un relevé?
Il faut plusieurs sortes d'instruments pour effectuer un relevé convenable. Ces instruments ont été divisés en deux groupes: le groupe A et le groupe B.
Le prix de tous les articles des groupes A et B varie considérablement selon le pays d'origine, la marque, etc.
Les instruments du groupe A sont très onéreux; ils doivent être loués ou empruntés au bureau local des travaux publics ou à un entrepreneur. Il est préférable de s'assurer les services d'un opérateur ou d'un géomètre relevant du même bureau. Les instruments du groupe A sont illustrés aux figures 5 à 9.
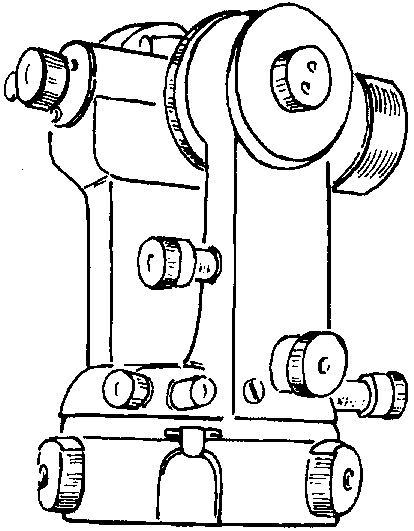
Figure 5 Théodolite
Le théodolite (figure 5) est l'instrument de base pour mesurer les lignes et les angles sur de grandes distances. A l'origine, il s'agissait d'un simple appareil d'optique, mais de nos jours, la plupart des théodolites comportent un dispositif électronique de mesure de distance. Pour ce qui nous occupe, il suffit de disposer d'un simple instrument d'optique.
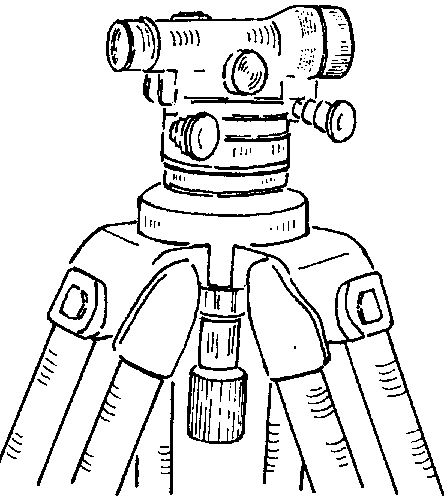
Figure 6 Niveau
Le niveau (figure 6) est le deuxième instrument en importance de tout géomètre. Il sert à mesurer la différence de niveau de deux points éloignés.
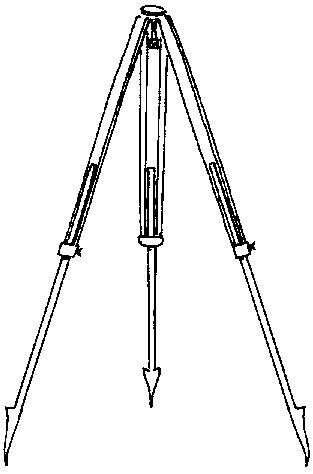
Figure 7 Trépied (groupe A)
Le trépied (figure 7) sert simplement de support au théodolite ou au niveau. On utilise généralement un seul trépied pour ces deux instruments. Lorsqu'on emprunte un théodolite ou un niveau, il faut s'assurer que le boulon de fixation du trépied s'adapte bien aux deux instruments, car certaines marques ne sont pas interchangeables; par exemple, on peut y fixer le théodolite, mais pas le niveau. Dans ce cas, il faut se procurer un trépied pour chaque instrument.
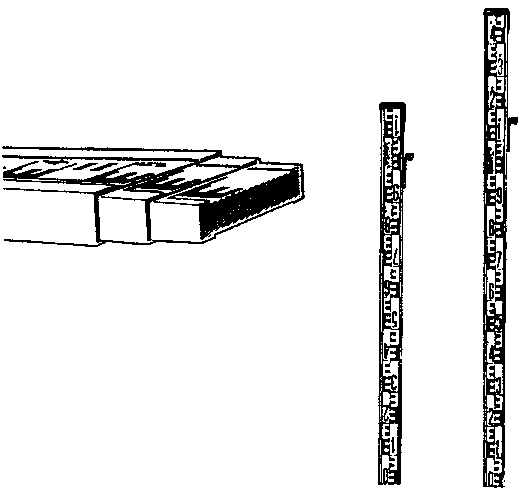
Figure 8 Mire
La mire (figure 8) s'utilise exclusivement avec le niveau. Si le niveau est neuf, la mire qui l'accompagne sera numérotée dans le bon sens (chiffres à l'endroit); si le niveau est plus ancien (20 ans ou plus), la numérotation peut être inversée (chiffres à l'envers). Les nouvelles mires sont en métal, et les anciennes en bois. Vérifiez la graduation; la mire doit être graduée en mètres.
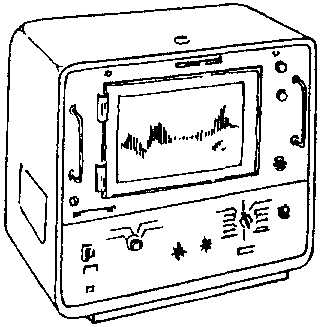
Figure 9 Sondeur à écho
Le sondeur à écho (figure 9) utilisé pour effectuer un relevé diffère de l'appareil utilisé sur les bateaux de pêche pour repérer le poisson. Il s'agit d'un instrument de précision servant uniquement à mesurer la profondeur de l'eau. Les services hydrographiques, les services de travaux publics et les autorités portuaires se servent d'ordinaire de ce type d'appareil pour surveiller l'envasement des chenaux d'accès des grands ports. Un appareil portatif de cette sorte est habituellement livré avec une paire de câbles de batterie spéciaux, une tête de transduction indépendante, un ou deux rouleaux de papier thermique et une pointe de rechange. Il fonctionne à l'aide d'une batterie d'automobile de 12 volts bien chargée.
Les articles du groupe B sont assez bon marché et certains peuvent même être fabriqués sur place à l'aide de matériaux peu coûteux. Quelques instruments du groupe B sont illustrés aux figures 10 à 16.
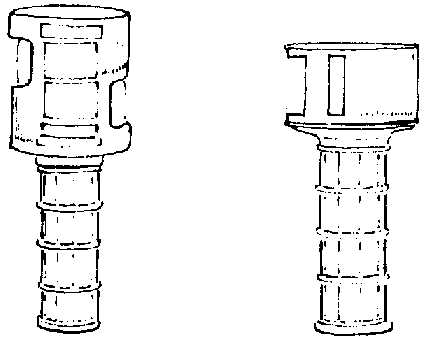
Figure 10 Goniomètre à réflecteur
Le goniomètre à réflecteur (figure 10) sert à mesurer des déplacements angulaires de 90° par rapport à une ligne droite tracée sur le sol.
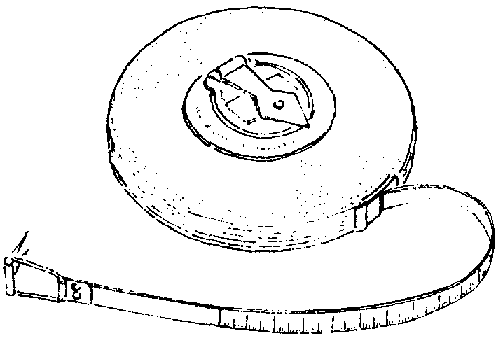
Figure 11 Ruban à mesurer
Les rubans à mesurer en fibres ou en plastique (figure 11 ) ont généralement une longueur de 20, 30, 50 ou 100 m, et leur prix varie considérablement. Un ruban en acier est plus précis, mais il nécessite davantage d'entretien et coûte très cher. Pour ce qui nous occupe, un ruban en plastique suffit.
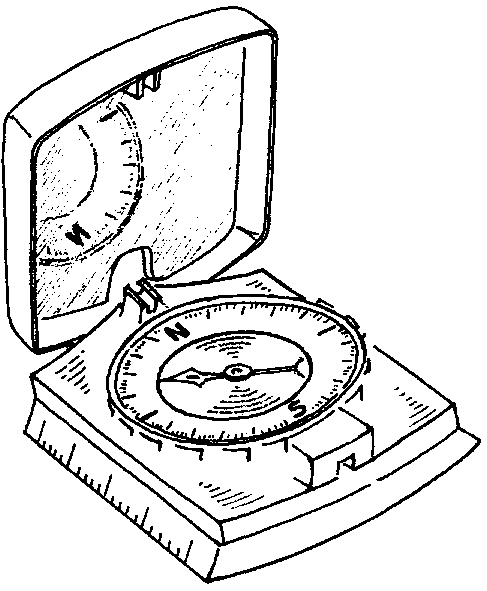
Figure 12 Boussole
Une petite boussole à main à bain d'huile (figure 12) sert à prendre des relèvements ou des caps par rapport à des repères permanents (relief, extrémité d'une île, etc.) lorsqu'on observe des phénomènes naturels tels que vent, vagues ou courants.
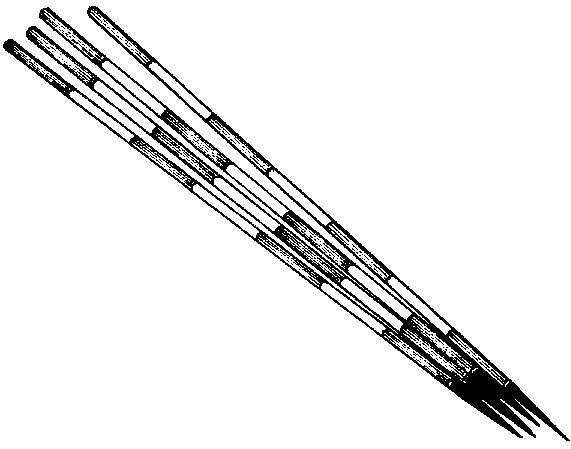
Figure 13 Jalons
Les jalons (figure 13) sont de simples pieux colorés utilisés pour tracer des lignes sur le sol. On peut soit les acheter en bloc, soit les fabriquer à l'aide de tronçons de tube droit longs d'environ 1,5 m, sur lesquels on peint des bandes rouges et blanches (larges de 150 mm, comme l'illustre la figure 13).
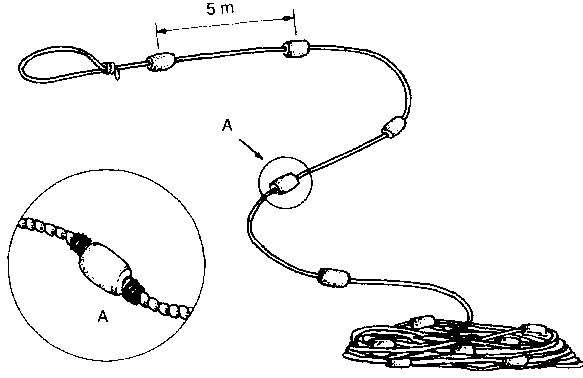
Figure 14 Ligne à flotteurs
Une ligne à flotteurs (figure 14) consiste en une corde en polypropylène de 6 mm de diamètre munie de petits flotteurs rouges en liège espacés de 5 m et de flotteurs de couleurs différentes espacés de 10, 20 ou 50 m. Elle sert à mesurer les distances en mer à partir d'un point fixe du rivage. Habituellement, ces lignes mesurent environ 200 m de long et sont enroulées sur un tambour ou dans un panier de pêche rond.
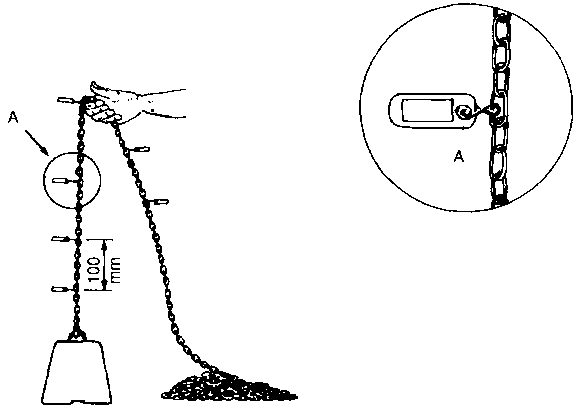
Figure 15 Chaîne de sonde
Une chaîne de sonde ou ligne de sonde (figure 15) est une chaîne légère ordinaire, munie d'un poids de 1 kg à son extrémité. Elle doit être graduée à des intervalles de 100 mm et sert à mesurer la profondeur de l'eau.
On peut la fabriquer très facilement à l'aide d'une chaîne métallique ordinaire, d'étiquettes en plastique et de fil de fer. Le poids est normalement en plomb.
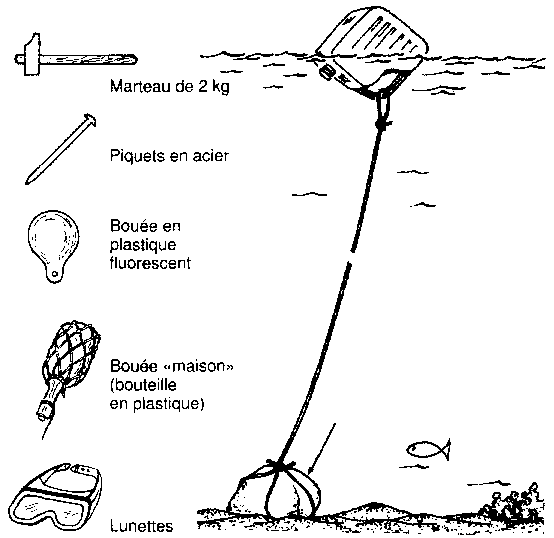
Figure 16 Autres articles
La figure 16 présente divers articles qui peuvent être achetés ou fabriqués. Les piquets servent à fixer des marques de grande dimension dans le sol. Il est souvent nécessaire de se procurer de la peinture rouge ou blanche pour pouvoir peindre des marques lorsqu'il n'est pas possible d'utiliser des piquets, par exemple sur un mur en pierre ou un arbre. Les flotteurs et leurs poids morts permettent de repérer certains points en mer.
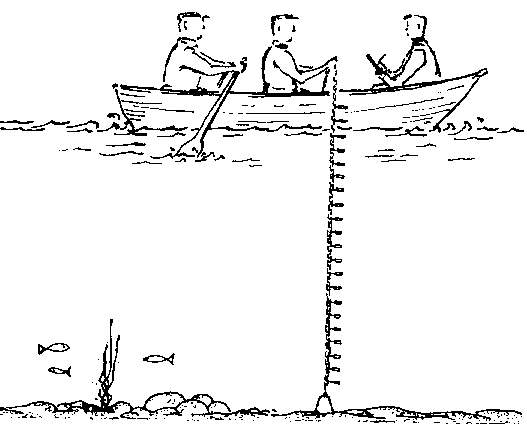
Figure 17 Bateau de relevé
Enfin, il faut disposer d'un bateau (figure 17) pour mesurer la profondeur au large. Il est préférable que ce soit un bateau en bois relativement lourd, de sorte qu'il résiste aux vents latéraux. Les bateaux en fibre de verre ont tendance à dériver très facilement. Lorsqu'on utilise une chaîne à main, il faut avoir une paire de rames. L'équipage doit être composé de trois personnes: le pilote, l'homme de chaîne et un assistant qui note les mesures.
Comme il a déjà été souligné, nous supposerons qu'en cas de location ou d'emprunt d'un théodolite, d'un niveau ou d'un sondeur à écho, l'établissement concerné fournit également un opérateur qui se charge de faire fonctionner l'instrument.
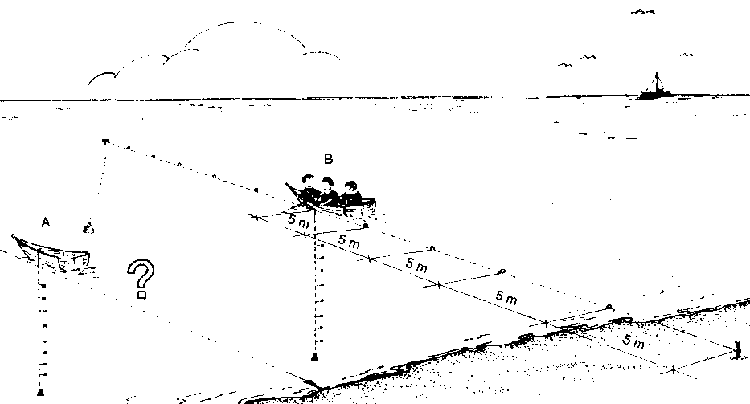
Figure 18 Utilisation d'une ligne à flotteurs pour déterminer la position de chaque sondage (bateau B)
Carte topographique
Une carte topographique doit être établie par un spécialiste. Le relevé topographique étant une opération compliquée, le présent ouvrage ne donnera pas d'informations détaillées à ce sujet.
Carte bathymétrique
Une carte bathymétrique est un plan du fond marin. Chaque courbe de niveau correspondant à une profondeur donnée est représentée par une ligne sur laquelle la profondeur en mètres est clairement indiquée. Le relevé effectué pour obtenir la carte bathymétrique est appelé relevé hydrographique.
La mesure effective de la profondeur constitue la partie la plus facile d'un relevé hydrographique. Le principal problème consiste à savoir à quelle distance du rivage se trouve le bateau lorsque la profondeur est mesurée.
Ainsi, le bateau A de la figure 18 est dépourvu de point de référence par rapport à la côte. Le bateau B, par contre, utilise une ligne à flotteurs étalonnée (figure 14) pour déterminer sa position par rapport au rivage (dans ce cas, 20 m sur la ligne droite joignant le piquet et la bouée).
La ligne à flotteurs doit être installée ou mise à flot entre deux points, à savoir un piquet planté sur le rivage et une bouée flottant au large (figure 18). La position du piquet planté dans le sol est facile à déterminer et doit être rapportée à la carte topographique du rivage proche de l'abri envisagé.
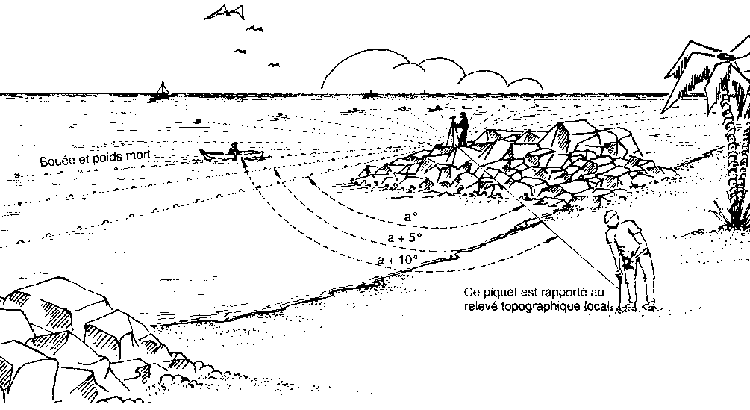
Figure 19 Méthode des rayons utilisée pour déterminer la position des sondages
La méthode des rayons et celle des lignes parallèles sont deux techniques simples de détermination de la position de la bouée à laquelle doit être fixée la ligne à flotteurs.
Il est toujours judicieux de poursuivre le relevé sur une certaine distance (de 50 à 100 m) de part et d'autre de l'abri ou du débarcadère envisagé.
On peut mesurer la profondeur réelle de l'eau en immergeant simplement la chaîne de sonde (figure 15) tous les 5 ou 10 m. La personne qui manipule la chaîne indique à haute voix la profondeur mesurée à un autre membre de l'équipage, qui note ces chiffres dans l'ordre voulu. Cette méthode permet d'obtenir un quadrillage fondé sur de simples mesures ponctuelles (figure 21).
Si on dispose d'un sondeur à écho et d'un opérateur expérimenté, la profondeur réelle est alors enregistrée par l'instrument lui-même sur un rouleau de papier spécial. Dans ce cas, l'opérateur seul embarque avec le pilote dans le bateau de relevé qui va et vient le long des lignes à flotteurs graduées. On obtient ainsi un profil continu du fond enregistré sur la bande de papier. Sur cette bande, la profondeur peut être arrondie au demi-centimètre le plus proche.
Lors de l'établissement d'une carte bathymétrique ou d'une carte à quadrillage, il faut se rappeler quelques points importants:
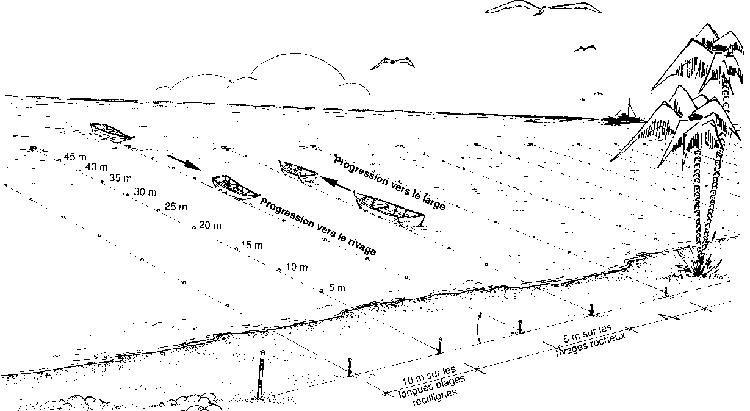
Figure 20 Méthode des lignes parallèles utilisée pour déterminer la position des sondages
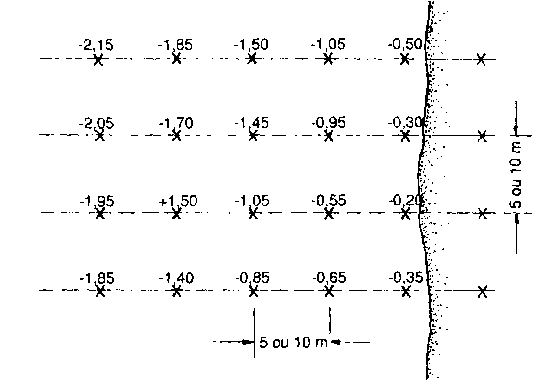
Figure 21 Sondages reportés à l'aide de la méthode des lignes parallèles (le signe + indique la présence d'un affleurement rocheux situé au-dessus du niveau moyen de la mer; les profondeurs sont exprimées en millimètres)
Une carte à quadrillage détaillée (figure 21) suffit d'ordinaire pour le travail courant effectué sur la côte. A l'échelon local (village), il est déconseillé d'essayer de transformer une carte à quadrillage de ce genre en une carte en courbes de niveau; cette tâche doit être accomplie par un géomètre du bureau des travaux publics. Si le relevé a été effectué à l'aide d'un sondeur à écho, l'opérateur est tout désigné pour interpréter l'enregistrement sur bande et élaborer la carte en courbes de niveau.
Relevé des marées
Il est possible que vous soyez obligé de demander l'aide d'un géomètre ou d'un agent de vulgarisation expérimenté pour bien comprendre la suite des relevés.
Il est essentiel de bien faire la distinction entre «marée» et «courant de marée». La marée est un déplacement périodique vertical du niveau de la mer, alors qu'un courant de marée, même engendré par la marée, est un mouvement périodique horizontal.
Les marées influent sur la profondeur de l'eau en un endroit donné; les courants de marée influent sur les routes des navires.
Par suite du cycle solaire, on enregistrera les marées hautes maximales et les marées basses minimales (les marées de vive-eau) au moment de la nouvelle et de la pleine lune, et les marées hautes minimales et les marées basses maximales (les marées de morte-eau) au moment du premier et du dernier quartier de la lune. Les marées obéissent donc à deux cycles distincts: des fluctuations du niveau de la mer entre les marées de vive-eau et les marées de morte-eau deux fois par mois lunaire (29 jours), et des oscillations du niveau marin entre marée haute et marée basse deux fois par jour lunaire.
Il s'agit là d'une explication succincte du phénomène des marées. D'autres facteurs entrent bien entendu en jeu. Il faut aussi tenir compte du fait que les orbites de la terre et de la lune sont elliptiques et non circulaires, ce qui exerce un effet saisonnier (équinoxe) sur l'amplitude de l'onde de marée (marée astronomique). Par ailleurs, le vent et la pression barométrique ont une influence aléatoire sur les marées: un vent soufflant vers le rivage a généralement tendance à amplifier la marée, alors qu'un vent soufflant vers le large a tendance à l'atténuer. De plus, un vent qui souffle dans la direction vers laquelle progresse la crête de l'onde de marée a tendance à hâter le moment de la marée haute, et vice versa. L'amplitude de la marée peut varier de 100 mm à plusieurs mètres. Dans la plupart des pays, on peut se procurer des annuaires des marées en s'adressant aux services hydrographiques ou aux autorités portuaires.
Les marées jouent un rôle essentiel dans la sécurité de la navigation. Tout navigateur, qu'il soit pêcheur ou capitaine de ferry, se demande constamment quelle est la profondeur de l'eau sous son bateau.
Pour que les navires puissent naviguer en toute sécurité dans les ports aménagés par l'homme, toutes les profondeurs sondées sont rapportées au zéro des cartes ou au niveau de basse mer de vive-eau, et les hauteurs terrestres au niveau de pleine mer de vive-eau.
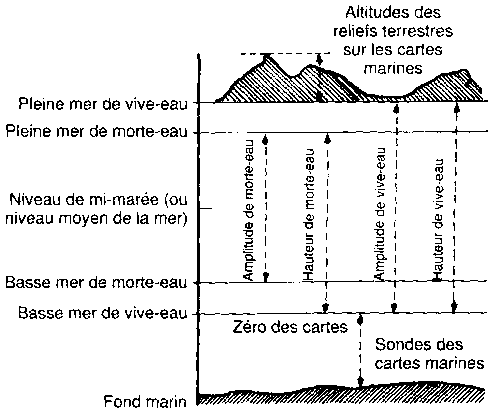
Figure 22a Marées
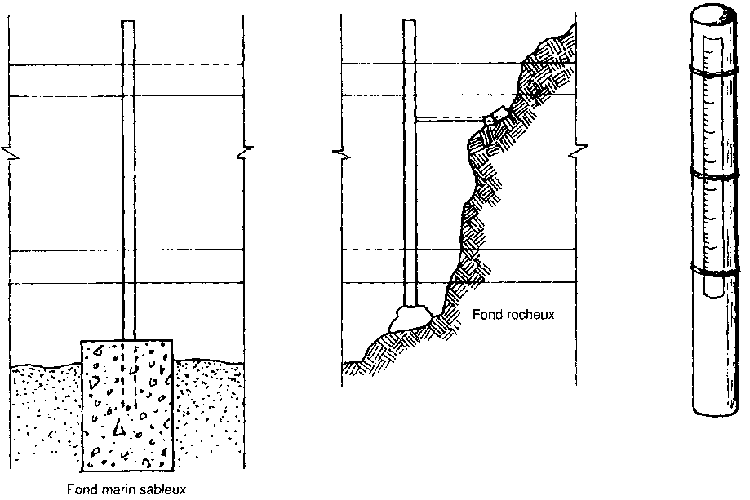
Figure 22b Méthodes permettant de mesurer leurs fluctuations
Pour établir un annuaire des marées propre à une zone ou à un village côtier particulier, on n'a besoin que d'une simple échelle de marée installée dans un endroit relativement calme. Cette échelle de marée (également appelée «marégraphe>) peut être facilement fabriquée à l'aide d'un tube en acier ou en plastique, ou d'une perche, sur lequel on fixe un morceau de ruban à mesurer en plastique; un mètre de couturière fait parfaitement l'affaire (figure 22b).
Dans une zone sableuse, le tuyau ou la perche est placé verticalement dans un baril que l'on remplit de béton ou de pierres et qu'on enfouit dans un endroit assez calme où la lecture du niveau ne soulève pas de difficulté. Dans une zone rocheuse, le poteau ou le tuyau doit être bétonné dans une cavité du rocher. Il convient de confier l'installation de l'échelle de marée à un géomètre équipé d'un niveau et d'une mire. De l'observation du niveau de la mer quelques jours avant et après une nouvelle lune, on peut déduire le niveau de basse mer de vive-eau—le point le plus bas atteint par le niveau de l'eau—et installer l'échelle de marée en conséquence. En plaçant le zéro du ruban à mesurer à ce niveau, on peut ainsi enregistrer les variations des marées dans toute leur amplitude. Une fois l'échelle de marée installée, il faut prendre note du niveau de la mer à intervalles réguliers, par exemple toutes les heures, pendant deux mois et reporter ces informations dans un annuaire, en indiquant l'heure, la date et les conditions météorologiques.
Relevé des courants de marée
Le phénomène des marées décrit ci-dessus engendre des courants de marée, qui sont des mouvements périodiques horizontaux de l'eau. Si ces mouvements sont nuis ou négligeables en haute mer, ils sont souvent importants dans les zones côtières caractérisées par un déplacement vertical appréciable.
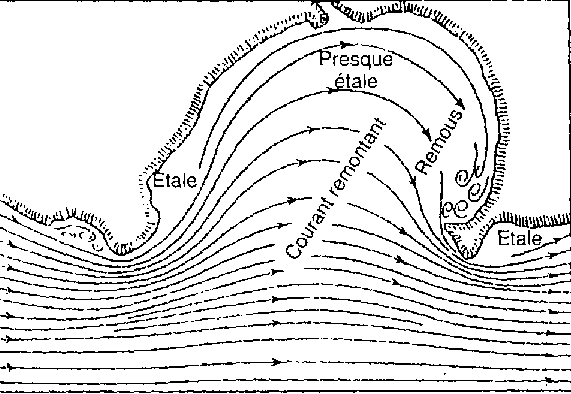
Figure 23 Influence de la forme de la côte sur la direction et le sens d'un courant de marée côtier
Les courants de marée résultent essentiellement d'une variation de niveau des eaux. La vitesse moyenne de ces courants est fonction de la hauteur moyenne de l'onde de marée montante. En haute mer, où cette hauteur est faible, la vitesse est minime ou négligeable, alors qu'elle est élevée dans les zones où la hauteur de l'onde est importante. Tout obstacle au mouvement de va-et-vient d'un courant de marée modifie la direction et la vitesse de ce courant. C'est ainsi qu'un courant de marée qui rencontre un promontoire est dévié autour de lui et voit généralement sa vitesse augmenter localement juste après l'obstacle (figure 23). Le courant contourne le promontoire et est dévié dans la baie, ce qui engendre un courant remontant de direction et de vitesse indéterminées. Dans la baie proprement dite, la dispersion de l'effet du courant et le fait que la force effective s'exerce d'un promontoire à l'autre et laisse des eaux relativement immobiles entre les deux ont pour conséquence de réduire la vitesse.
En l'absence de marées, de faibles courants marins peuvent être engendrés par de fortes tempêtes. Ces courants, bien qu'ils ne soient pas aussi puissants que les courants de marée, doivent être néanmoins observés avec soin, car ils transportent habituellement des algues arrachées au large.
Les courants rendent généralement la navigation plus difficile mais pas impossible. Toutefois, lorsqu'ils charrient des algues ou des épaves flottantes (et notamment des troncs d'arbres et des végétaux amenés par les cours d'eau), il est impossible de naviguer, les algues venant se prendre dans les hélices. Les épaves ou les débris flottants peuvent aussi s'avérer gênants lorsqu'ils s'accumulent dans les ports sous l'effet d'un courant de marée ou d'un courant marin dominant.
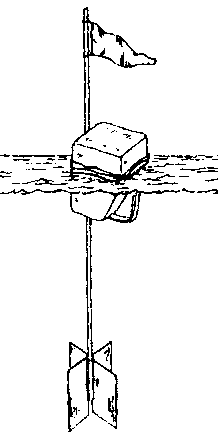
Figure 24 Flotteur constitué d'un simple bidon
La force d'un courant peut être mesurée en chronométrant le temps qu'il met pour parcourir une distance connue le long de la côte ou pour traverser une baie. On peut se servir d'un simple flotteur constitué d'un bidon lesté par un contrepoids placé à environ 1 m au-dessous de la surface de l'eau (figure 24) en vue de mesurer la force d'un courant. Lorsqu'on mesure des courants en mer, il faut prêter attention aux points suivants:
Relevé de la hauteur des vagues
Pour déterminer la nature précise des diverses sortes de vagues parvenant jusqu'en un point donné du rivage, il existe trois méthodes différentes:
Les deux premières méthodes donnent des résultats très précis, mais sont très coûteuses; on les réserve d'ordinaire aux projets d'envergure nécessitant des données précises sur les vagues. La troisième méthode n'est pas très précise, mais elle est relativement bon marché et correspond mieux au dessein du présent manuel. Elle ne diffère de la première méthode que par un seul aspect: l'observateur.
Dans la première méthode, l'observateur est un appareil électronique permettant de procéder à un enregistrement continu au large, c'est-à-dire là où les vagues ne subissent pas encore l'influence du rivage. A l'inverse, dans la troisième méthode, l'observateur est un simple géomètre qui utilise un théodolite installé en un point stratégique et sûr pour observer les vagues proches du rivage. Les hauteurs de vagues ainsi mesurées sont donc altérées et ne sont exploitables que dans le cas de petits projets.
Aménagement d'un point d'observation des vagues
Pour aménager un point d'observation des vagues, il faut se procurer le matériel suivant: deux grosses bouées fluorescentes en plastique d'environ 500 mm de diamètre (une rouge et une blanche), un gros poids mort en pierre ou en béton, un morceau de corde en nylon de 10 mm de diamètre, un théodolite, une boussole et une montre munie d'une trotteuse ou d'un dispositif d'affichage numérique.
En un point stratégique, qui doit être juste assez élevé par rapport au niveau de la mer pour rester sûr et sec pendant une tempête, on érige alors un socle en pierre sur lequel on bétonne une vis de fixation, de sorte que le théodolite, chaque fois qu'il est installé, se trouve exactement dans la même position et soit braqué dans la même direction (figure 25).
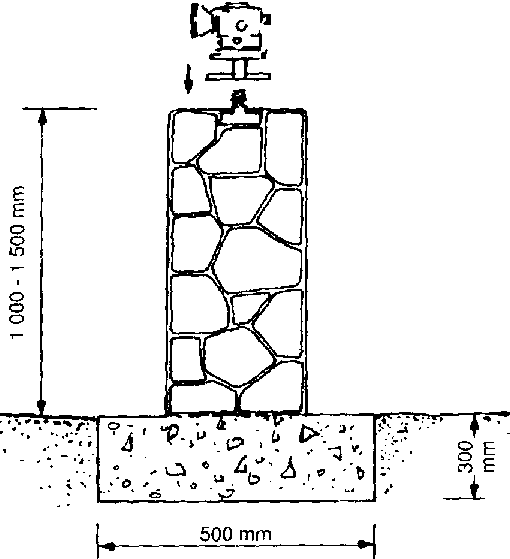
Figure 25 Socle d'observation en pierre et en béton
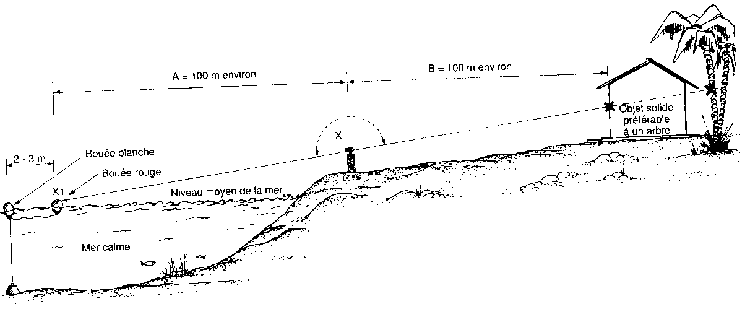
Figure 26 Aménagement d'une station d'observation des vagues
Les deux bouées fluorescentes en plastique sont alors mouillées au large à une distance connue (par exemple 100 m), comme l'illustre la figure 26. La bouée blanche maintient la ligne de mouillage bien tendue, alors que la bouée rouge flotte librement au gré des vagues.
Pour étalonner la station, on pointe le théodolite sur la bouée par temps calme. On fait alors une marque repère sur un objet robuste (un mur, par exemple, est préférable à un arbre), de sorte que l'observateur puisse de nouveau pointer l'oculaire sur cette position de repos précédemment établie, même si la bouée est ballottée par les vagues pendant une tempête. Cela permet, entre les tempêtes, d'utiliser le théodolite à d'autres fins que l'observation de la hauteur des vagues (figure 26).
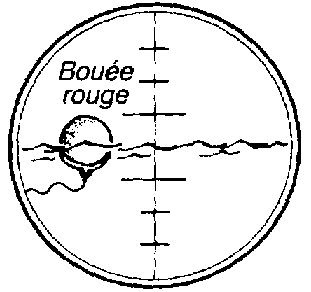
Figure 27a Image perçue à travers l'oculaire du théodolite
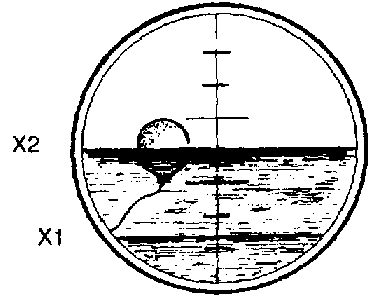
Figure 27b Image perçue à travers l'oculaire au passage des vagues entrantes
La figure 27a montre l'image perçue à travers l'oculaire du théodolite par temps parfaitement calme, la base de la bouée se trouvant juste au-dessus du réticule central.
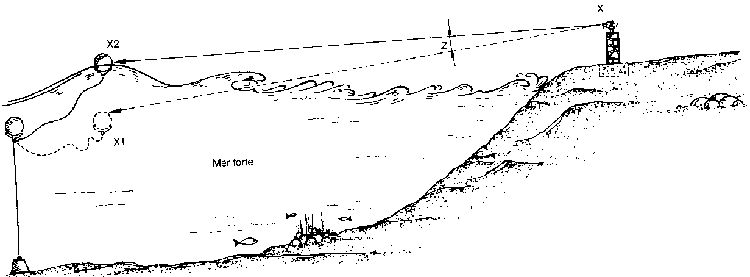
Figure 28 Observation des vagues pendant une tempête
Pendant une tempête, la bouée est ballottée de haut en bas au rythme des vagues. En déplaçant le réticule central de sorte qu'il coïncide avec la base de la bouée, on fait décrire au théodolite un petit angle Z (figure 28). Conformément aux principes élémentaires de l'arpentage, la distance entre le théodolite et la bouée et l'angle Z permettent de calculer la hauteur d'une vague, qui représente approximativement le double de la hauteur de déplacement au-dessus du niveau de la mer par temps calme. Cependant, il faut souligner que ce calcul est très approximatif et n'est utilisable que dans le cas de petits projets. Lorsqu'on observe la hauteur des vagues, il faut aussi noter les informations supplémentaires suivantes:
Comme il a déjà été mentionné, différents inconvénients font que cette méthode doit être réservée aux petits projets, où l'investissement financier prévu est très limité. Ces inconvénients sont essentiellement les suivants:
Une fois le relevé d'emplacement terminé, toutes les données recueillies doivent être reportées sur un plan de situation, avec l'aide d'un géomètre.
Le chapitre 9 décrit certaines des échelles et certains des symboles le plus couramment employés dans les plans de situation.
En principe, le plan de situation devrait inclure le relevé hydrographique (sous forme de quadrillage ou de courbes de niveau) et indiquer l'emplacement du futur abri de pêche.
Les différents accès et les points cotés doivent aussi être reportés sur le plan, au même titre que les équipements proches (puits d'eau douce, canalisations d'eau, lignes électriques, etc.).
Les données relatives à la marée, aux courants de marée et aux vagues doivent être présentées sous forme de tableaux. Avant d'entamer les travaux, il est préférable de montrer le plan à un ingénieur du bureau des travaux publics, afin que ce dernier puisse faire des commentaires et des suggestions.