Précautions à prendre sur le lieu des travaux
Qu'est-ce qu'un bon mélange de béton?
Proportions du ciment et des autres ingrédients
Addition
d'eau
Bois
d'œuvre
Les matériaux de construction habituellement requis pour les travaux en mer sont les suivants: ciment, agrégats (sable et pierres), acier d'armature, blocaille, pieux en bois ou en acier, éléments de fixation, moises de palplanches ou poutres et divers autres articles accessoires.
Le ciment est une poudre gris-vert qui durcit en quelques heures après adjonction d'eau et dont la solidité s'accroît avec le temps. Parmi les nombreux types de ciment disponibles, le plus courant est le ciment Portland ordinaire. C'est toutefois le ciment résistant au sulfate qui convient le mieux aux travaux en mer. Le ciment est généralement vendu dans des sacs en papier de 50 kg.
Pour obtenir un béton de qualité, il faut lier les fragments de pierres avec une pâte de ciment de manière à obtenir un mélange aussi dense et non poreux que possible. En conséquence, il importe que l'agrégat (de sable et de pierres) soit dur pour que le béton ait une résistance suffisante. Pour convenir, l'agrégat ne doit pouvoir être rayé que par une lame de canif en acier. Le béton fabriqué avec de la pierre corallienne tendre est peu résistant et s'effrite avec le temps.
Les constituants des agrégats broyés sont anguleux, alors que les graviers de rivière ou de plage sont arrondis. Les agrégats prélevés en mer contiennent du sel—substance dont s'accommode très mal le béton—et doivent donc être lavés plusieurs fois à l'eau douce avant d'être utilisés à cette fin.
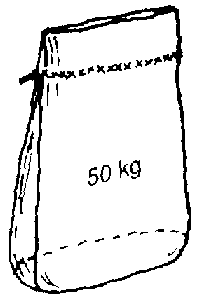
Figure 52 Ciment
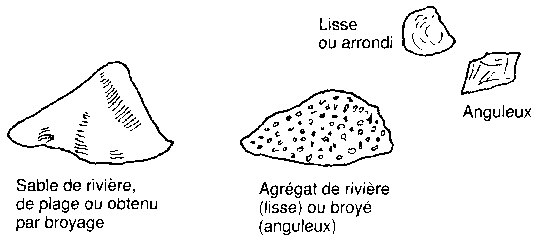
Figure 53 Agrégats
Les agrégats coralliens ne doivent être employés qu'en dernier ressort, et uniquement si les conditions du milieu permettent de prélever du corail vivant.
Les carrières constituent les sources les plus sûres de blocaille pour la construction. Une carrière produit généralement des pierres de toutes les dimensions, et l'obtention des bonnes dimensions dépend pour une grande part de l'expérience du carrier responsable de la fragmentation à l'explosif, ainsi que de l'homogénéité géologique du terrain. Comme dans le cas des agrégats, la résistance est fonction de la dureté de la roche. Une roche qui se raye très aisément ne convient pas pour des brise-lames, des quais ou des ouvrages qui sont au contact de l'eau de mer, et il faut alors chercher une autre source d'approvisionnement.
L'acier d'armature placé au sein du béton sert à accroître la résistance de ce dernier. Dans le cas des travaux en mer, l'acier doit être recouvert d'au moins 50 mm de béton pour échapper à la corrosion par l'eau de mer.
Les barres d'acier ont d'ordinaire un diamètre qui varie de 6 mm à 32 mm. Les barres d'acier sont habituellement vendues au poids; les poids (en kilogrammes par mètre) correspondant aux diamètres les plus courants sont les suivants:
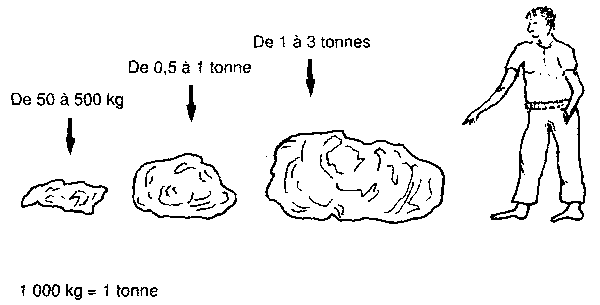
Figure 54 Blocaille
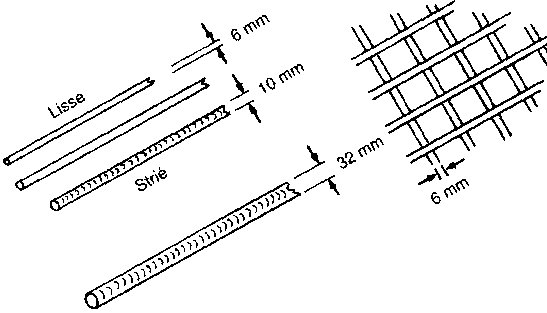
Figure 55 Acier d'armature, barres et treillis soudé
6 mm de diamètre: 0,222 kg/m
8 mm de diamètre: 0,395 kg/m
10 mm de diamètre: 0,617 kg/m
12 mm de diamètre: 0,888 kg/m
14 mm de diamètre: 1,208 kg/m
18 mm de diamètre: 1,988 kg/m
20 mm de diamètre: 2,466 kg/m
24 mm de diamètre: 5,551 kg/m
La longueur des barres d'acier ne dépasse généralement pas 12 m. L'armature se présente aussi sous forme de treillis en acier soudé.
Précautions à prendre sur le lieu des travaux
Tout comme un bon cuisinier sait comment conserver les produits pour qu'ils restent frais, il faut s'assurer que les matériaux de construction sont bien conservés sur le chantier; il suffit d'appliquer quelques règles simples:
Lors de travaux en milieu marin, on fait souvent usage de pieux en acier, en bois ou en béton armé (figure 57).
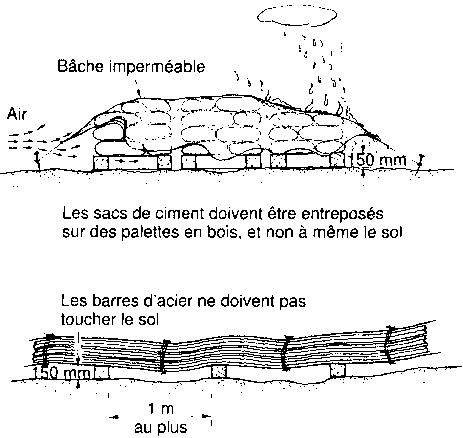
Figure 56 Entreposage du ciment et de l'acier
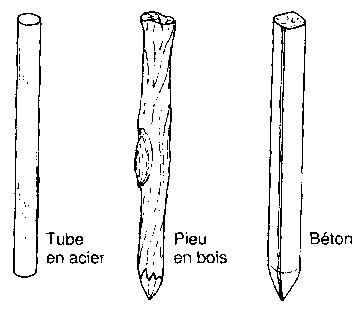
Figure 57 Pieux
L'emploi de pieux s'impose lorsque le sol est très mou (marais, marécages ou lits de cours d'eau boueux); dans ce cas, on enfonce un certain nombre de pieux dans le sol afin d'édifier une fondation stable.
Pour éviter que les pieux se détériorent, il faut les protéger: les pieux en acier doivent être recouverts de peintures spéciales à la résine époxy, les pieux en bois doivent être traités à la créosote et les pieux en béton doivent être fabriqués avec du ciment résistant au sulfate.
Les différentes pièces en bois sont maintenues entre elles par des éléments de fixation. Selon les dimensions effectives de ces pièces, on utilise des vis ou des boulons, mais jamais de clous. En effet, lorsque les clous sont corrodés, ils se cassent net sans aucun signe de faiblesse préalable.
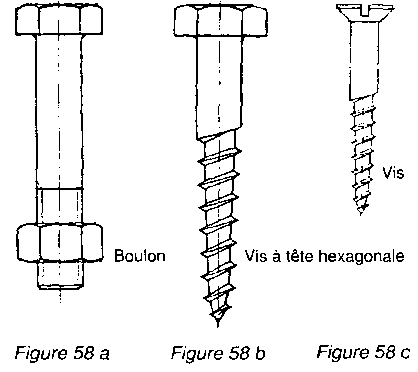
Figure 58 Eléments de fixation
La figure 58a représente un boulon à tête hexagonale, qui doit être impérativement en acier galvanisé, ou encore mieux en laiton ou en acier inoxydable.
La figure 58b représente une vis à tête hexagonale à haute résistance, là encore en laiton ou en acier galvanisé.
La figure 58c représente une vis à tête conique classique, qui doit être de préférence en laiton.
Qu'est-ce qu'un bon mélange de béton?
De nos jours, le béton est le principal matériau de construction, et la science du mélange de ses divers ingrédients s'appelle le dosage du mélange de béton.
Un bon mélange permet d'obtenir un béton dense, solide et qui résiste aux éléments. Un tel mélange est une recette équilibrée, composée de ciment, d'agrégat fin (sable), d'agrégat grossier (pierres) et d'eau douce.
Ciment. Comme il a été mentionné précédemment, il faut utiliser du ciment Portland ordinaire ou, mieux encore, du ciment résistant au sulfate datant au plus de six semaines.
Agrégat fin. L'agrégat fin consiste en sable de plage lavé ou en agrégat broyé provenant d'une carrière avoisinante. Ce sable, quelle que soit son origine, ne doit pas contenir de quantités excessives de limon ou de poussière.
Agrégat grossier. L'agrégat doit être constitué de pierres de moins de 50 mm; il doit en outre être dur et non poreux et ne pas contenir de quantités excessives de poussière. Le corail ne doit pas être utilisé à cette fin, car il est trop tendre et poreux et contient du sel marin, qui a un effet dommageable sur l'acier d'armature.
Eau. Il faut utiliser de l'eau potable propre, exemple d`impuretés telles que le sel.
Proportions du ciment et des autres ingrédients
Les proportions du ciment et des autres ingrédients sont fonction de la solidité, de l'imperméabilité et de la résistance requises. L'expérience a montré qu'un béton de proportions 1:2:4 (c'est-à-dire une part de ciment pour deux parts de sable et quatre parts d'agrégat de pierres) convient parfaitement aux travaux généraux de construction, tant du point de vue du coût que de celui de la solidité. Les mélanges plus riches en ciment ( 1: 1:2, par exemple) sont plus solides, mais plus chers du fait de la proportion plus grande de ciment.
Au lieu de simplement utiliser un mélange riche, il est généralement plus économique de préparer le béton de qualité nécessaire en calibrant et en mélangeant avec soin les agrégats et l'eau selon les proportions habituelles ( 1:2:4).
Le mélange de béton 1:2:4. Lorsqu'on utilise un sac ordinaire de ciment de 50 kg comme base de mesure. un mélange 1:2:4 contient' en poids, 50 kg de ciment, 100 kg de sable et 200 kg d'agrégat grossier. Toutefois, comme il n'est pas toujours possible de peser des quantités aussi importantes d'agrégat, on peut utiliser un mélange équivalent en volume.
Mélange équivalent en volume. A chaque sac de 50 kg de ciment, il convient d'ajouter 0,07 m³ de sable et 0,14 m³ de cailloux.
Mélange en volume. Pour mélanger les matériaux ci-dessus, il faut fabriquer une boîte de mesure en bois aux dimensions intérieures de 400 mm x 400 mm x 200 mm (figure 59). A l'aide d'une pelle, on remplit alors cette boîte de sable et d'agrégat grossier, puis on égalise en déplaçant une règle sur le dessus de la boîte, comme indiqué à la figure 59.
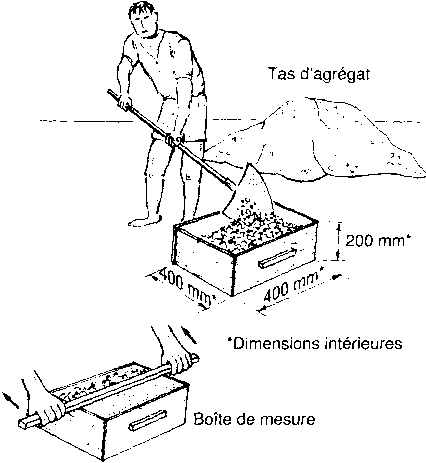
Figure 59 Mélange de béton en volume
Une boîte de ce type contient 0,035 m; de sable et d'agrégat grossier. Par conséquent, un mélange 1:2:4 équivaut à:
un sac de ciment de 50 kg
plus
deux mesures (boîtes) de sable
plus
quatre mesures (boîtes) d'agrégat grossier
Quelle que soit la taille de la bétonnière, la gâchée ou le mélange doivent toujours respecter les proportions ci-dessus.
Ainsi, s'il s'agit d'une grosse bétonnière, ces proportions seront de quatre (boîtes) de sable et de huit (boîtes) de cailloux pour deux sacs de ciment.
La solidité et l'aptitude au façonnage du béton sont subordonnées, dans une large mesure, à la quantité d'eau incorporée dans le mélange. Pour chaque mélange, il existe une quantité d'eau optimale qui permet d'obtenir un béton d'une solidité maximale.
L'addition d'une quantité d'eau inférieure à cette quantité optimale réduit l'aptitude au façonnage du béton, qui se révèle alors trop dur à travailler. A l'inverse, l'addition d'une quantité d'eau supérieure à la quantité optimale accroît l'aptitude au façonnage (le béton étant plus fluide), mais réduit la solidité et la résistance.
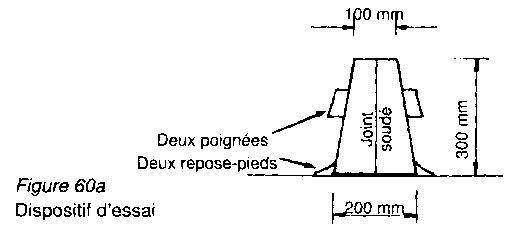
Figure 60 Essai permettant de déterminer l'aptitude au façonnage du béton (figure 60a)
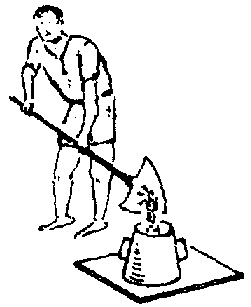
Figure 60b Remplissage avec du béton frais
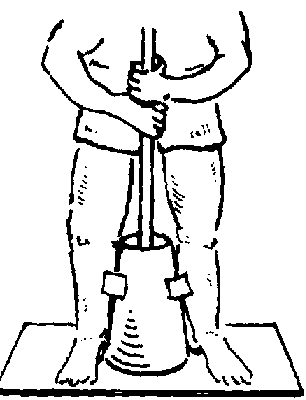
Figure 60c
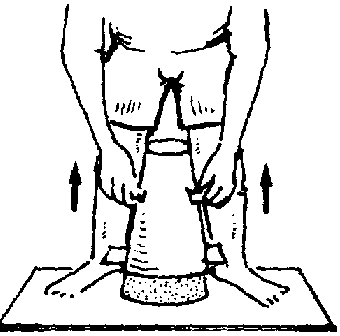
Figure 60d
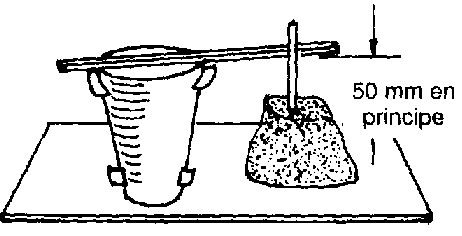
Figure 60e Mesure de l'affaissement
La quantité d'eau optimale est tributaire des facteurs suivants:
La méthode d'évaluation la plus pratique de la quantité d'eau optimale permettant d'obtenir le béton le plus solide possible consiste à ajouter l'eau petit à petit dans la bétonnière et à effectuer une série d'essais en procédant comme suit.
On fabrique d'abord un cône tronqué (ouvert à son extrémité) avec un morceau de tôle mince et lisse (figure 60a). Il convient en principe de souder le joint verticalement sur un côté, de souder également deux poignées (une de chaque côté) et de faire en sorte que l'intérieur soit parfaitement lisse. Il faut en outre copieusement graisser l'intérieur pour l'empêcher de rouiller.
Après avoir ajouté suffisamment d'eau dans la bétonnière pour que le béton soit humide mais néanmoins épais, on remplit le cône de trois couches successives de béton, que l'on tasse à la main à l'aide d'une barre en acier de 20 mm de diamètre. On lisse alors le dessus à la truelle et on retire le cône. Dès que le cône est enlevé, le béton s'affaisse, comme le montre la figure 60. A toutes fins pratiques, cet affaissement devrait idéalement atteindre 50 mm.
Si l'affaissement du béton n'atteint pas 50 mm, il faut ajouter un peu d'eau dans la bétonnière et répéter l'essai jusqu'à ce qu'on obtienne la bonne valeur. L'eau doit être ajoutée demi-litre par demi-litre (à l'aide d'un bidon mesureur), et non pas directement au tuyau. Pour plus de précisions sur la manipulation et la mise en place du béton, se reporter à l'annexe 1.
Le bois d'œuvre est le résultat de la coupe et du débitage des arbres, eux-mêmes fruits de la nature et du temps. Le bois est considéré comme un matériau à bon marché et efficace, et on continue à l'employer en grandes quantités. Cependant, de graves dommages peuvent être causés à l'environnement par suite d'une utilisation excessive ou d'un mauvais usage de l'un des principaux produits de la nature. Contrairement à beaucoup d'autres matériaux utilisés dans la construction, le bois ne se fabrique pas selon des spécifications particulières.
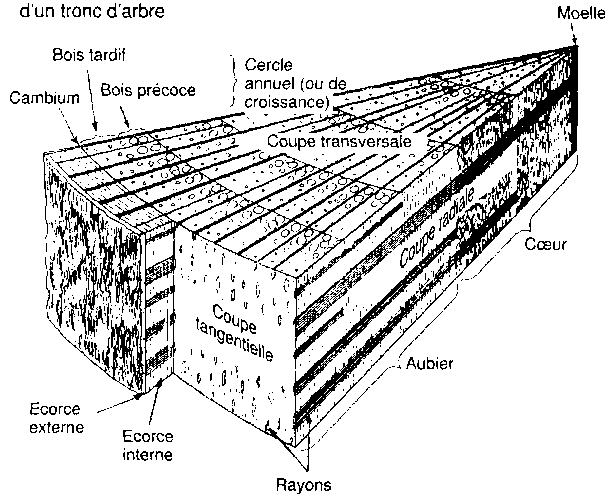
Figure 61 Coupe transversale d'un tronc d'arbre
Il faut donc faire le meilleur usage du matériau qui existe déjà. La résistance est un terme employé ici dans son sens le plus large; il recouvre la résistance à l'action corrosive de l'eau de mer et à l'action nuisible des champignons et des insectes, mais aussi la résistance des dispositifs de fixation à la corrosion.
Un tronc d'arbre comporte deux parties distinctes: une partie interne, le cœur, et une partie externe, l'aubier (figure 61).
L'aubier du bois de certains feuillus est caractérisé par la présence de vaisseaux ou pores de grand diamètre et d'un nombre restreint de fibres. Dans le cœur, les pores ont un diamètre bien moindre et l'essentiel des tissus consistent en fibres. Il n'est donc pas étonnant que seul le cœur ait une faible porosité et convienne aux travaux entrepris en mer.
Organismes marins térébrants
Le bois plongé dans l'eau de mer ou dans des eaux saumâtres (salées) est exposé aux attaques d'organismes marins térébrants (ou perforants) tels que le taret et la limnorie (figure 62) . Ces organismes sont largement répandus, mais sont particulièrement actifs dans les eaux tropicales. La plupart des essences n'ont pas une résistance suffisante aux térébrants pour être utilisées sans traitement. La figure 62 montre comment la limnorie et le taret détruisent les structures du bois.
Tableau 1 - Essences qui résistent bien à l'action des organismes marins térébrants
| Continent | Source | Désignation commune |
| Afrique | Plantation | Opepe |
| Asie | Plantation | Teck |
| Australie | Essences indigènes | Eucalyptus résineux |
| Australie | Plantation | Gommier bleu |
| Amérique du Sud et | Forêts ombrophiles | Greenheart |
| Amérique centrale | Forêts ombrophiles |
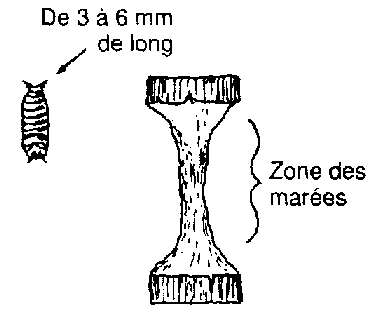
Figure 62 Dégâts causés par les térébrants aux pieux en bois (Figure 62a Limnorie et effet «en sablier» de leur action sur les pieux)
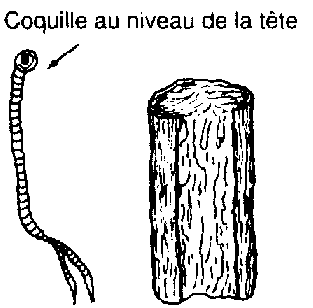
Figure 62b Taret et intérieur perforé d'un pieu
Cependant, certaines essences résistent bien à l'action des organismes marins térébrants. Plusieurs d'entre elles particulièrement résistantes poussent dans les forêts tropicales ombrophiles, qui sont en voie de disparition rapide. Ces forêts sont une source non renouvelable de bois et ne devraient pas être exploitées. Il est donc préférable d'utiliser des essences poussant dans des plantations, qui constituent, quant à elles, une source renouvelable. Le tableau 1 énumère certaines essences qui résistent bien à l'action des organismes marins térébrants et indique les continents où elles poussent.
Outre qu'il est très dense et très peu poreux, le bois de cœur de ces essences sécrète des substances toxiques qui le protègent des térébrants. Il peut donc être utilisé sans traitement pour façonner des pieux à usage marin ou construire des appontements.
En revanche, le bois d'aubier des mêmes essences est plus poreux et sécrète beaucoup moins de substances toxiques protectrices. Pour des travaux en mer, il est judicieux d'utiliser du bois qui a été au préalable imprégné sous pression d'agents préservatifs. Les agents préservatifs qui conviennent sont la créosote, les solutions de créosote et de goudron de houille et les mélanges de cuivre, de chrome et d'arsenic dissous dans l'eau. L'expérience a montré que du bois imprégné avec soin d'un de ces agents préservatifs reste intact très longtemps. C'est pourquoi il vaut mieux choisir du bois facile à traiter et répéter le traitement (par immersion) après qu'il a été coupé et que les trous ont été percés.
Comme les conditions ambiantes et les ressources en bois varient d'un endroit à l'autre, il convient de s'adresser à la commission ou au bureau des produits forestiers le plus proche pour savoir quel est le bois renouvelable qu'il convient d'utiliser.
Résistance
Dans le cas des travaux en mer, le terme «résistance» est pris dans son acception la plus large. La résistance au pourrissement de la plupart des essences varie considérablement, et même le bois provenant d'un même arbre peut, de ce point de vue, présenter des différences importantes. Selon la résistance manifestée par le bois de cœur au contact du sol, on a classé le bois d'œuvre en cinq grandes catégories:
Le bois qui se trouve au contact direct de l'eau de mer ou de l'eau saumâtre (les pieux d'un appontement, par exemple) doit être du bois de cœur d'une des essences considérées comme très résistantes, par exemple l'opepe ou l'eucalyptus résineux (tableau 2).
Tableau 2 - Résistance des différents bois
| Assez résistant | Résistant | Très résistant |
| (de 10 à 15 ans) | (de 15 à 25 ans) | (plus de 25 ans) |
| Feuillus | ||
| Chêne | Agba (tola) | Afrormosia |
| Sapelli | Idigbo | Afzelia |
| Seraya | Acajou1 | Azobé |
| Noyer² | Chêne³ | Greenheart |
| Acajou4 | Châtaignier | Iroko |
| Jarrah | ||
| Makoré | ||
| Opepe | ||
| Teck | ||
| Résineux | ||
| Mélèze | Pin rigide | |
| Sapin de Douglas | If | |
| Pins | Cèdre rouge d'Occident |
Notes:
1 D'Amérique
2 D'Europe et d'Afrique
3 D'Europe
4 D'Afrique
5 Maritime
Tout bois d'aubier non traité est périssable. Seul le bois de cœur des essences mentionnées dans la dernière colonne résistent naturellement aux organismes marins térébrants.
Le bois utilisé à l'extérieur, mais qui n'est pas au contact direct de l'eau de mer ou de l'eau saumâtre (le tablier d'un appontement, par exemple) peut être en bois «résistant» ou «assez résistant» (chêne, châtaignier, sapin de Douglas, pin maritime, etc.), dans la mesure où ce bois a été traité avec un agent préservatif.
Le bac destiné au traitement du bois par immersion peut être constitué d'une série de moitiés de fûts soudées ensemble (figure 63). Les morceaux de bois à traiter doivent être auparavant coupés aux dimensions requises et percés aux endroits appropriés. On les immerge ensuite dans un bain contenant un agent préservatif, par exemple du créosote, pendant 24 heures. Une fois le traitement achevé, il importe de laisser le bois sécher avant de le manipuler.
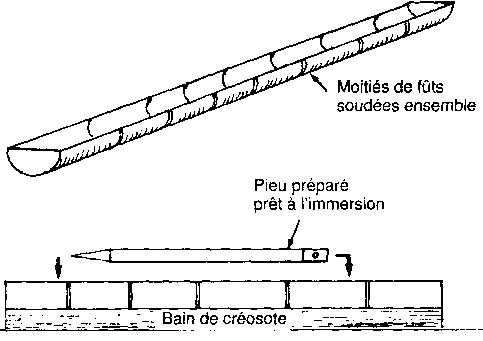
Figure 63 Traitement sur place par immersion