Un phénomène ne peut être maitrisé que lorsqu'on connait les paramètres qui influent sur ce dernier. C'est pourquoi, la gestion rationnelle des pêcheries nécessite avant tout la connaissance réelle des ressources exploitées, l'identification de tous les facteurs halieutiques (effort de pêche) et environnementaux (facteurs du milieu) qui influencent les ressources (N'Goran, 1995).
Afin de promouvoir des mesures d'aménagement assorties d'une réglémentation permettant une exploitation rationnelle des plans d'eau qui rétablisse leur niveau d'exploitation et les accroissements, une démarche s'impose :
- faire l'état des connaissances sur les principales ressources exploitées ;
- faire le point des catégories d'engins utilisées et de leur sélectivité vis-à-vis des espèces exploitées ;
- faire le point des efforts de pêche déployés ;
- connaitre la dynamique des opérateurs en activité sur ces pêcheries.
Dans les cours d'eau, la pêche est pratiquée surtout par des pêcheurs occasionnels riverains du fleuve et par des pêcheurs professionnels itinérants. Dans certains cas, des pêches aux poissons sont pratiquées avec la plante ichtyotoxique, Téphrosia vogeli (Elouard et al, 1982).
Il est donc difficile d'estimer l'effort de pêche et la quantité de poissons capturées, étant donné la très grande dispersion des activités de pêche.
Sur le Bandama, les activités de pêche se déroulent dans les pêcheries établies à :
- Grand Lahou, Tiassalé et Oumé sur le cours inférieur ;
- Bada (Marabadiassa, Alasso, Niakaramandougou-Tortiya) sur le cours moyen ;
- Kombolodougou sur le cours supérieur.
Dans les lacs, la pêche est pratiquée essentiellement par des pêcheurs professionnels et rarement par quelques nationaux.
La pratique de la pêche par les bozos est liée par certaines considérations techniques et culturelles :
- les catégories d'engins ;
- l'appartenance religieuse du pêcheur ;
- l'appartenance ethnique du pêcheur ;
- la situation géographique du campement de pêche.
Suivant les engins:
- l'utilisation des sennes se fait dans la journée ;
- les filets maillants sont posés généralement à la tombée de la nuit et relevés tôt le matin. La réparation des filets se font durant la journée;
- les nasses et les bambous sont posés de façon permanente et saisonnière et visités chaque matin. Os sont utilisés dans les zones encombrées de bois morts.
Suivant l'appartenance religieuse du pêcheur et la position du campement
- les pêcheurs non musulmans pèchent sept jours sur sept ;
- les pêcheurs musulmans habitant dans le village pêchent six jour sur sept (le Vendredi étant le jour de repos) ;
- les pêcheurs musulmans dont les campements sont éloignés du village, pêchent cinq jours sur sept, le Vendredi étant considéré comme le jour de repos et un autre jour est consacré au marché.
Suivant l'appartenance ethnique :
- le pêcheur ivoirien ne sort pas par jour de grand vent
La mise en oeuvre d'une politique cohérante de développement de la pêche exige la maitrise des trois composantes indispensables à une gestion rationnelle des écosystèmes aquatiques :
- la productivité potentielle qui est la quantité de poissons qu'un lac peut théoriquement produire chaque année si toutes les conditions optimales sont réunies ;
- la production est la quantité de poissons réellement produite par les pêcheurs;
- la demande est la quantité de poissons nécessaire pour satisfaire les besoins des consommateurs d'une région ou d'un pays.
Afin d'éviter la surexploitation tout en permettant l'exploitation optimale des ressources, il convient de déterminer le nombre idéal de pêcheur qu'un lac peut supporter. Pour ce faire, il faut prendre en compte la production potentielle du lac, le rendement moyen par pêcheur professionnel.Le potentiel de production d'un lac s'obtient en multipliant la productivité estimée par unité de surface (ha) par la surface moyenne du lac. Cette productivité par unité de surface s'obtient si l'on connait la conductivité moyenne des eaux du lac et la profondeur moyenne du lac. Pour chaque lac, la superficie est donnée.
Tableau 25 : Production potentielle et production réelle du lac de Buyo
| Année | Superficie moyenne (ha) | Production réelle (tonnes) | Production potentielle (tonnes) | Ecart (tonnes) |
| 1982 | 66 000 | 1964 | 4.923 | +2959 |
| 1983 | 52 000 | 1 553 | 4.336 | + 2783 |
| 1984 | 39 000 | 3800 | 3.305 | -495 |
| 1985 | 41 000 | 6 500 | 4.006 | -2494 |
| 1986 | 68 000 | 6000 | 5.174 | -826 |
| 1987 | 51 000 | 7 500 | 4.151 | -3349 |
| 1988 | 54000 | 10474 | 4.287 | -6 187 |
| 1989 | 10500 | |||
| 1990 | 7925 | |||
| 1991 | 5900 | |||
| 1992 | ||||
| 1993 | ||||
| 1994 | ||||
| 1995 |
Tableau 26: Production potentielle et production réelle du lac d'Ayamé
| Année | Superficie moyenne (ha) | Production réelle (tonnes) | Production potentielle (t ) | Ecart (tonnes) |
| 1972 | 11.660 | 274 | 828 | + 554 |
| 1973 | 12.980 | 177 | 1.035 | + 858 |
| 1974 | 12.980 | 307 | 1.004 | + 697 |
| 1975 | 11.260 | 339 | 828 | + 489 |
| 1976 | 11.800 | 626 | 963 | +337 |
| 1977 | 8.280 | 653 | 636 | - 17 |
| 1978 | 9.920 | 629 | 917 | + 288 |
| 1979 | 13.980 | 712 | 1.057 | + 345 |
| 1980 | 11.460 | 646 | 828 | + 182 |
| 1981 | 11.740 | 409 | 969 | + 560 |
| 1982 | 12.170 | 630 | 973 | + 343 |
| 1983 | 11.800 | 605 | 636 | + 31 |
| 1984 | 8.280 | 751 | 917 | + 166 |
| 1985 | 9920 | 684 | 1057 | + 373 |
| 1986 | 13 980 | 741 | 828 | + 87 |
| 1987 | 11460 | 659 | 969 | + 310 |
| 1988 | 11740 | 770 | 973 | + 203 |
| 1989 | 12170 | 660 | 905 | + 245 |
| 1990 | 12772 | 728 | 907 | + 179 |
| 1991 | 11 716 | 332 | 832 | + 500 |
| 1992 | 12364 | 420 | 878 | + 458 |
| 1993 | 11262 | 225 | 898 | + 576 |
| 1994 | 11419 | 352 | 912 | + 560 |
| 1995 | 11619 | 353 | 928 | + 575 |
Tableau .27 : Production potentielle et production réelle du lac de Taabo
| Année | Superficie moyenne (ha) | Production réelle (tonnes) | Production potentielle (tonnes) | Ecart (tonnes) |
| 1990 | 2.800 | 435 | ||
| 1979 | 6.130 | 433 | ||
| 1980 | 6.120 | 391 | ||
| 1981 | 5.650 | 395 | ||
| 1982 | 5.680 | 345 | ||
| 1983 | 4.920 | 380 | ||
| 1984 | (4.490) | 416 | ||
| 1985 | (5.970) | 400 | ||
| 1986 | 5.870 | 431 | ||
| 1987 | 5.190 | 429 | ||
| 1988 | 6.500 | 401 | ||
| 1989 | 6.150 | 418 | ||
| 1990 | 5.700 | 397 | ||
| 1991 | 6.150 | 462 | ||
| 1992 | 6.300 | 202 | ||
| 1993 | 6.500 | 328 | ||
| 1994 | 6.150 | 363 | ||
| 1995 | 6.500 | 378 |
Tableau 28 : Taille et poids des principales espèces de poissons capturées dans les lacs
| ESPECES | Taille à la capture | Poids à la capture | ||||
| LT/Ls (mm) | maxi | LT/Ls (mm) | mini | Maximum (grammes) | Minimum (grammes) | |
| Polypterus endlicheri | 740/698 | 296/256 | 623 | 170 | ||
| Pellonula leonensis | 110/92 | 75/65 | 12 | 3 | ||
| Heterotis niloticus | 1080/1010 | 147/130 | 12475 | 29 | ||
| Marcusenius furcidens | 272/231 | 102/81 | 207 | 19 | ||
| Marcusenius ussheri | 375/330 | 110/95 | 325 | 8 | ||
| Marcusenius senegalensis | 325/283 | 110/100 | 226 | 6 | ||
| Petrocephalus bovei | 112/85 | 70/62 | 45 | 8 | ||
| Mormyrus rume | 950/885 | 196/178 | 4962 | 34 | ||
| Mormyrops anguilloides | 995/954 | 305/280 | 5942 | 94 | ||
| Hepsetus odoe | 510/435 | 205/460 | 555 | 58 | ||
| Alestesbaremoze | 315/540 | 121/82 | 203 | 8 | ||
| Brycinus imberi | 200/168 | 85/65 | 104 | 5 | ||
| Brycinus nurse | 205/185 | 85/66 | 147 | 5 | ||
| Brycinus macrolepidotus | 410/385 | 82/66 | 585 | 3 | ||
| Brycinus longipinnis | 110/90 | 105/80 | 19 | 4 | ||
| Hydrocynus forskalii | 780/725 | 125/100 | 485 | 10 | ||
| Barbus macrops | 120/99 | 90/70 | 27 | 4 | ||
| Barbus trispilos | 86/68 | 72/55 | 9 | 4 | ||
| Barbus waldroni | 275/238 | - | 480 | 35 | ||
| Barbus wurtzi | 285/320 | - | 420 | 48 | ||
| Labeo coubie | 900/775 | 110/75 | 1920 | 40 | ||
| Labeo senegalensis | 925/808 | 125/96 | 2070 | 52 | ||
| Labeo parvus | 315/255 | 106/77 | 385 | 12 | ||
| Raiamas senegalensis | 228/183 | 197/156 | 95 | 57 | ||
| Raiamas nigeriensis | 137/111 | 122/97 | 26 | 16 | ||
| Distichodus rostratus | 760/717 | 190/150 | 1645 | 72 | ||
| Auchenoglanisoccidentalis | 510/430 | - | - | - | ||
| Chrysichthys nigrodigitatus | 590/485 | 80/55 | 2320 | 35 | ||
| Chrysichtys maurus | 420/310 | 100/60 | 595 | 15 | ||
| Parailia pellucida | 90/70 | - | - | - | ||
| Schilbe intermedius | 417/350 | 87/73 | 422 | 5 | ||
| Heterobranchus isopterus | 790/735 | 82/67 | 15330 | 4 | ||
| Heterobranchus longifilis | 930/875 | 225/190 | 17312 | 57 | ||
| Malapteruruselectricus | 420/335 | 175/145 | 2975 | 31 | ||
| Synodontis bastiani | 235/205 | 80/59 | 435 | 22 | ||
| Synodontis schall | 390/310 | 78/56 | 365 | 7 | ||
| Synodontis punctifer | 365/285 | 70/48 | 350 | 12 | ||
| Synodontis koensis | 275 /195 | 120/95 | 220 | 13 | ||
| Parachanna obscure | 490/455 | 56/42 | 72 | 42 | ||
| Lates niloticus | 1870/1825 | 195 /165 | 765 | 47 | ||
| Chromidotilapiaguntheri | 175 /156 | 150/130 | 110 | 11 | ||
| Hemichromis fasciatus | 200/160 | 115/87 | 148 | 27 | ||
| Hemichromisbimaculatus | 195 /156 | 90/75 | 167 | 3 | ||
| Oreochromis niloticus | 515/465 | 65/50 | 2410 | 23 | ||
| Sarotherodon galilaeus | 380/300 | 75/57 | 1050 | 8 | ||
| Tilapiazillii | 305/234 | 70/55 | 565 | 9 | ||
| Clariasanguillaris | 920/885 | 67/53 | 10468 | 37 | ||
Selon les sources de la FAO (Welcomme, 1988), jusqu'en 1970, les pêches continentales représentaient 8,3% de l'effort de production halieutique nationale et se situaient en valeur absolue entre 4.000 et 6.000 tonnes par an alors que les pêches maritimes produisaient entre 55.000 et 80.000 tonnes par an. Puis de 1972 à 1990, avec la construction des lacs de Kossou, Taabo, Buyo et Faé, les productions fluviolacustres se sont accrues énormément puisqu'elles ont été évaluées entre 20.000 et 30.000 tonnes, soit 30% des productions nationales alors que les productions maritimes semblaient montrer un certain déclin. La production piscicole du lac d'Ayamé avait été estimée entre 800 et 1.200 tonnes par an ; celle du lac de Kossou se situe entre 7.500 et 10.000 tonnes par an, celle de Buyo entre 6.000 et 8.000 tonnes.
Depuis la mise en eau du lac, la production annuelle des pêcheries a connu une augmentation régulière d'année en année, passant de 1.553 tonnes en 1982 à 10.500 tonnes en 1989 (figure ...). Le poisson de Buyo arrive chez le consommateur à 80% sous la forme de poisson fumé et 20% de poisson frais. Le fumage du poisson de Buyo dure un à cinq jours avant son écoulement sur les marchés hebdomadaires. La perte encourue par le poisson frais lors de son fumage est évaluée à 40%. Par ailleurs, un pêcheur capture en moyenne entre 1 et 3 tonnes de poissons par an et l'apport des aides pêcheurs est estimé à une tonne par an (DCGTx, 1988). La production totale du lac peut donc être estimée en multipliant le nombre de pêcheurs par la production moyenne annuelle par pêcheur. Ce mode d'évaluation a permis à la Direction des Contrôles des Grands Travaux (DCGTx) d'estimer à 6000 tonnes la production annuelle optimale du lac de Buyo. Or les données recueillies sur le terrain montrent que depuis 1986, les pêcheries en activité sur ledit lac, sont en état de surproduction.
Tableau. 29 : Evolution des tonnages des productions piscicoles annuelles du lac
| Espèces | 1982 | 1983 | 1984 | 198S | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 |
| 0. niloticus | 190 | 406 | 1320 | 2632 | 2640 | 3756 | 5086 | 4206 | 3851 | 2470 |
| Sar. galilaeus | 106 | 169 | 104 | 586 | 590 | 406 | 855 | 611 | 244 | 244 |
| Tilapiazillii | 124 | 124 | 145 | 415 | 456 | 396 | 767 | 333 | 469 | 460 |
| H. fasciatus | 121 | 86 | 221 | 338 | 102 | 203 | 224 | 237 | 38 | 75 |
| Chrysichthys spp | 102 | 100 | 258 | 416 | 753 | 965 | 967 | 163 | 1235 | 1119 |
| Heterotisniloticus | 150 | 107 | 615 | 702 | 461 | 1027 | 1736 | 2317 | 1199 | 1012 |
| Heterobranchus sp | 1982 | 152 | 372 | 305 | 131 | 96 | 196 | 291 | 101 | 151 |
| Labeo spp | 171 | 66 | 122 | 143 | 127 | 112 | 60 | 130 | 75 | 49 |
| Schilbe spp | 42 | 25 | 68 | 108 | 64 | 61 | 87 | 112 | 39 | 19 |
| Characidae | 498 | 190 | 202 | 221 | 153 | 112 | 118 | 104 | 99 | 25 |
| Mormyridae | 62 | 50 | 88 | 88 | 73 | 106 | 96 | 99 | 59 | 50 |
| Synodontis spp | 76 | 59 | 103 | 84 | 80 | 90 | 98 | 202 | 417 | 153 |
| Divers | 124 | 19 | 182 | 462 | 270 | 173 | 184 | 228 | 99 | 90 |
| TOTAL | 1964 | 1553 | 3800 | 6500 | 6000 | 7500 | 10474 | 10500 | 7925 | 5917 |
a) Répartition des captures par famille
Les études menées par l'IDESSA ont montré que l'exploitation halieutique du lac est basée essentiellement sur la capture de cinq espèces:Oreochromis niloticus, Heterotis niloticus, Sarotherodon galilaeus, Chrysichthys maurus et Tilapia zillii. Seules trois familles sur les dix sept (17) que comporte le lac (Traoré, 1989), participent de façon significative à la production halieutique du lac. Il s'agit de la famille des Cichlidae, des Osteoglossidae et des Bagridae. Honnis la première année (1982) où les Characidae ont montré une prépondérance dans les captures, ces trois principales familles ont toujours fourni plus de 80% des captures.
Tableau 30 : Evolution inter-annuelle des taux de captures des principales espèces
| Espèces | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 |
| O. niloticus | 9,64 | 26,14 | 34,73 | 40,49 | 44 | 50.08 | 48,55 | 40.05 | 4859 | 41,74 |
| S. galilaeus | 539 | 10,88 | 2,73 | 9,01 | 9,83 | 5,41 | 8,16 | 5,81 | 3,07 | 4,12 |
| Tilapiazillii | 631 | 708 | 3,81 | 638 | 7.6 | 5,28 | 732 | 3,17 | 5,91 | 7,77 |
| Chrysichthys spp | 5,19 | 6,43 | 6,78 | 6,4 | 1255 | 12,86 | 923 | 15,52 | 1558 | 1801 |
| Heterotisniloticus | 7,63 | 6,88 | 16,18 | 10,8 | 7.68 | 13,69 | 16,57 | 22,06 | 15,12 | 17,10 |
| Heterobranchus sp | 10,08 | 9,78 | 9.78 | 4,69 | 2.18 | 128 | 1,87 | 2,77 | 127 | 255 |
| Synodontis spp | 3,86 | 3,79 | 2,71 | 1,29 | 133 | 12 | 0,93 | 1,92 | 5,26 | 258 |
| Labeo spp | 8,70 | 424 | 321 | 2,2 | 2,11 | 1,49 | 0,57 | 123 | 0,94 | 0,82 |
| Schilbe spp | 2,13 | 1,60 | 1,78 | 1,66 | 1,06 | 0,81 | 0,83 | 1,06 | 0,49 | 032 |
| Characidae | 2535 | 1223 | 531 | 3,4 | 2,55 | 1,49 | 1,12 | 0,99 | 124 | 0,42 |
| Divers | 631 | 1,22 | 4,78 | 7,10 | 4,5 | 230 | 1,75 | 2,17 | 124 | 152 |
| Hemichromissp | 6,16 | 5,53 | 5,81 | 5,2 | 1,7 | 2,70 | 2.13 | 225 | 0,47 | 126 |
| Mormyridae | 3,15 | 321 | 231 | 135 | 1.2l | 1,4l | 0,91 | 0,94 | 0,74 | 0,84 |
| TOTAL | 99,9 | 99,91 | 99,92 | 99,94 | 983 | 100 | 99,94 | 99,94 | 99,92 | 99,95 |
La famille des Cichlidae est de loin la mieux représentée dans les captures réalisées par les pêcheurs commerçants. En effet, on enregistre :
- dans la zone de pêche de Buyo, les Cichlidae représentent plus de 61,7% des captures totales dont
38,3% d'Oreochromis niloticus,
7,8% de Sarotherodon galilaeus,
9,8% deTilapia zillii
5,8% d'Hemichromis;
- dans la zone de pêche de Guessabo, les Cichlidae représentent 70% des captures totales dont
58,2% d'Oreochromis niloticus,
6,8% de Sarotherodon galilaeus,
4,2% de Tilapia zilli
0,8% d'Hemichromis;.
- dans la zone de pêche de Guiglo, les Cichlidae ont fourni en moyenne 70,4% des captures totales avec:
59,9% d'Oreochromis niloticus,
7,2%
de Sarotherodon galilaeus,
2,9% de Tilapia zillii
0,4% d'Hemichromis.
La famille des Osteoglossidae n'est représentée que par une seule espèce: Heterotis niloticus. Celle-ci a représenté en moyenne, 13,1% des captures totales réalisées dans la zone de pêche de Buyo, 16,1% à Guessabo et 15,3% à Guiglo. Sur toute l'étendue du lac, les captures d'Heterotis niloticus représentent en mo-yenne 14,8% des prises totales des pêcheries commerciales.
La famille des Bagridae est représentée par deux espèces: Chrysichthys maurus et Chrysichthys nigrodigitatus. En terme d'effectif de poissons capturés, les Chrysichthys sont très abondamment pêchés mais à des tailles généralement très petites à cause de l'utilisation abusive des pièges-bambou. En terme de biomasse, leurs captures paraissent relativement faibles. Celles-ci représentent en moyenne, 10,1% du poids total des captures réalisé sur le lac soit 17,4% dans la zone de pêche de Buyo, 9,8% dans la zone de Guessabo et 3,1% dans la zone de Guiglo.
b) Évolution des captures d'Oreochromis niloticus
Les tonnages annuels des captures de cette espèce sont passés de 190 tonnes en 1982 à 5086 tonnes en 1988 mais ils semblent se stabiliser autour de 3500 tonnes par an (tableau 30), ce qui représente un tonnage moyen annuel de 2676 tonnes soit une proportion moyenne de 44,4 %. D'après la figure .... les plus importantes captures sont réalisées au troisième trimestre de l'année, c'est-à-dire en juillet–août–septembre, ce qui correspond à la période des hautes eaux. En effet, à cette période de l'année, les captures ont représenté en moyenne 42 % des captures totales réalisées dans l'année. Le second meilleur score (27,8%) est obtenu durant le second trimestre de l'année, pendant la montée des eaux. La pêche est la moins fructueuse pendant le quatrième trimestre (période de décrue) puisqu'elle ne représente que 12,4 % des captures totales. Ces constats permettent de dire que les captures d'Oreochromis niloticus sont influencées par les variations saisonnières du régimes hydrologiques du lac. En effet, les captures augmentent progressivement avec le remplissage progressif du lac (avril–juin) pour atteindre un pic au troisième trimestre (Juillet–Septembre) avant de baisser progressivement avec la décrue et l'étiage. Il semble donc qu'il y a une corrélation positive entre l'évolution des captures d'Oreochromis niloticus et l'augmentation des surfaces pêchables matérialisées par le cycle de remplissage du lac. En effet, plus la surface pêchable est grande plus la production est importante.
c) Évolution des captures d'Heterotis niloticus
Le tonnage annuel des captures de cette espèce est passé de 150 tonnes en 1982 à 2.317 tonnes (tableau 30) et la production annuelle moyenne est estimée à 923 tonnes. H ressort de l'examen de la figure ...que le tonnage le plus important de l'année s'observe durant le quatrième trimestre avec une moyenne 38,3% des captures totales d'Heterotis niloticus réalisées au cours de l'année. Le second meilleur score est obtenu au premier trimestre (Janvier–Mars) et le plus mauvais score est fourni par le second trimestre avec seulement 11,4 %. A l'analyse, il ressort qu'il y a une corrélation négative entre l'évolution des captures d'Heierotis niloticus et le cycle hydrologique du lac. En effet, en période de remplissage du lac (avril–juin) et en période des hautes eaux (juillet–septembre), les captures d'Heterotis sont médiocres et les meilleurs rendements sont obtenus pendant la période de décrue et l'étiage (figure ...).
d) Évolution des captures de Chrysichthys sp.
Le tonnage produit par les captures de Chrysichthys a évolué entre 100 tonnes et. 1633 tonnes depuis la mise en eau du lac et le tonnage annuel moyen est de l'ordre de 645 tonnes (tableau 30). Avec 33,9 % des captures totales annuelles, le troisième trimestre fournit le meilleur rendement de l'année. Il est suivi par le second trimestre avec 26,4 % et par le premier trimestre qui fournit 23,5 %. Le plus mauvais score est réalisé au quatrième trimestre avec 16,2 % . Il y a donc une corrélation positive entre l'évolution des tonnages produits et les variations du cycle hydrologique.
e) Évolution des captures d'Heterobranchus sp.
Depuis la mise en eau du lac, le niveau de capture de cette espèce est passé de 95 à 372 tonnes par an (tableau 30) avec un tonnage annuel moyen de 205 tonnes. Les plus fortes captures (42%) sont réalisées durant le quatrième trimestre précisément dans les mares résiduelles qui se sont constituées après le retrait des eaux dans les zones d'inondation. Le second meilleur rendement est obtenu durant le troisième trimestre surtout dans les zones d'inondation.
f) Évolution des captures de Sarotherodon galilaeus
La production annuelle de cette espèce a varié entre 106 et 855 tonnes (tableau 30) avec une moyenne annuelle de 405 tonnes. Les plus fortes captures sont réalisées en périodes des hautes eaux c'est-à-dire au troisième trimestre avec 46,2% suivi par le second trimestre avec 27,1 % et par le premier trimestre qui fournit 15,4 %. Il y a une corrélation positive entre l'évolution des captures et les variations saisonnières du cycle hydrologique du lac.
g) Évolution des captures des Characidae
Alestes baremoze, Brycinus macrolepidotus, Brycinus nurse et Brycinus imberi sont les espèces de la famille des Characidae qui figurent dans les captures des pêcheurs commerçants. Depuis la mise en eau du lac, les captures des Characidae ont varié de 99 et 498 tonnes par an et cette production est régulièrement en baisse contrairement à celle des autres espèces (tableau 30). Il n'y a pas de période préférentielle de capture de ces espèces avec 21,8 % des captures pour le premier trimestre, 21,7 % pour le second trimestre, 28,8 % pour le troisième et 27,6 % pour le quatrième.
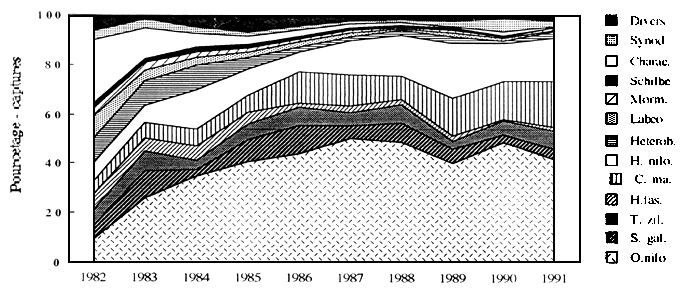
Figure : Evolution interannuelle des taux de captures des principales espèces
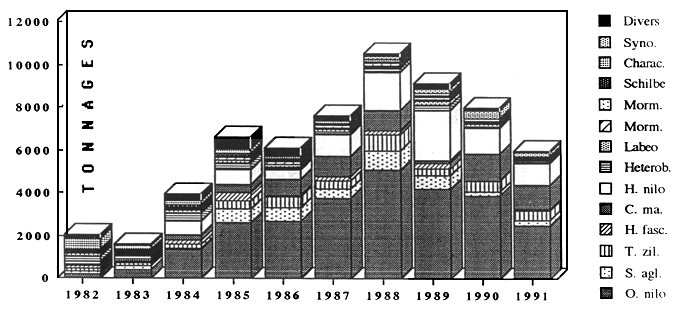
Figure3: Répartition pondÉrale des principales espèces capturées à BUYO
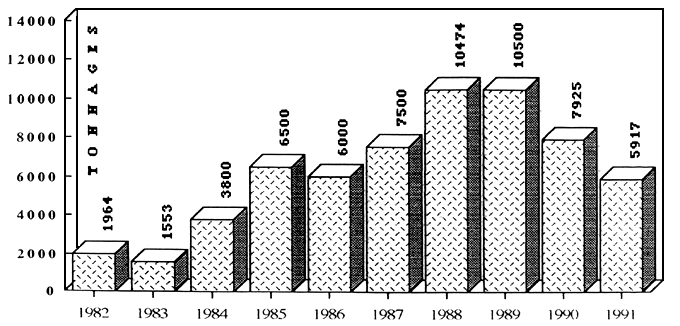
Figure 2: Productions piscicoles annuelles du lac de BUYO
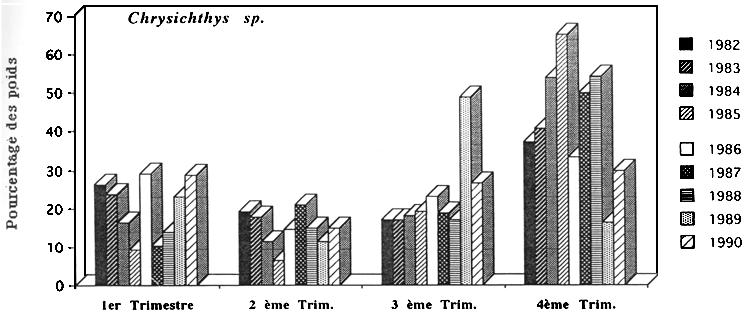
Figure : Evolution saisonnière des captures de Chrysichtys
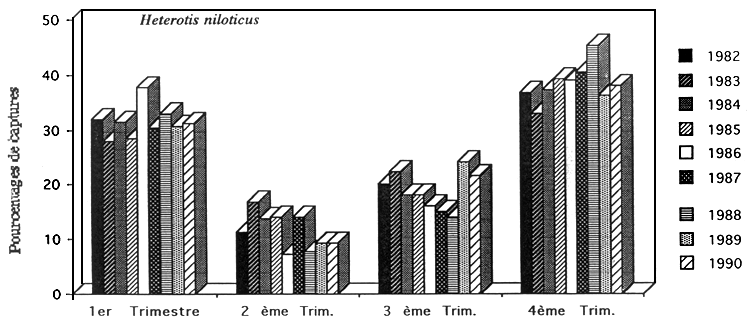
Figure 5 : Varions saisonnières des captures d'H. niloticus
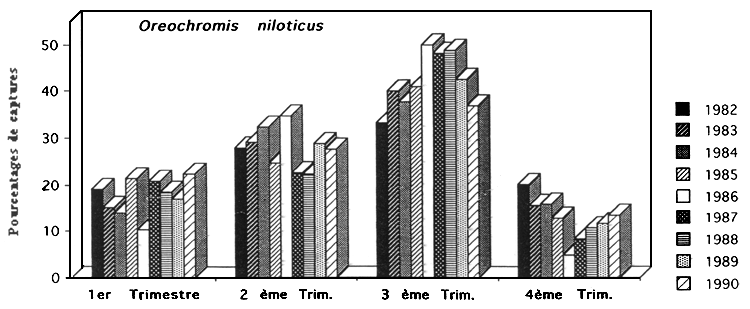
Figure 4 : varions des captures de Oreochromis niloticus
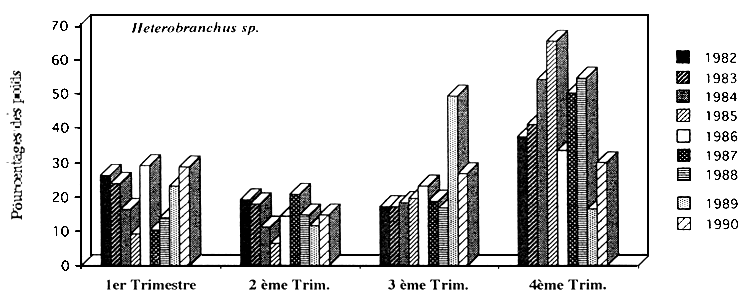
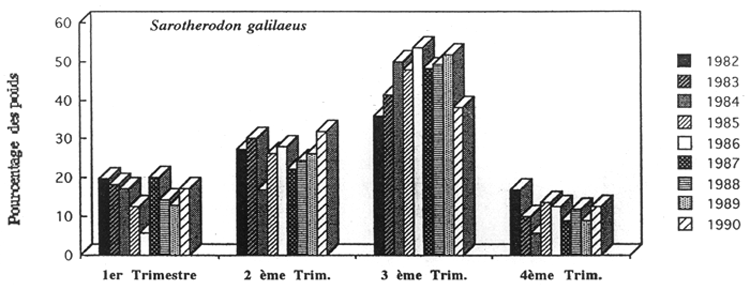
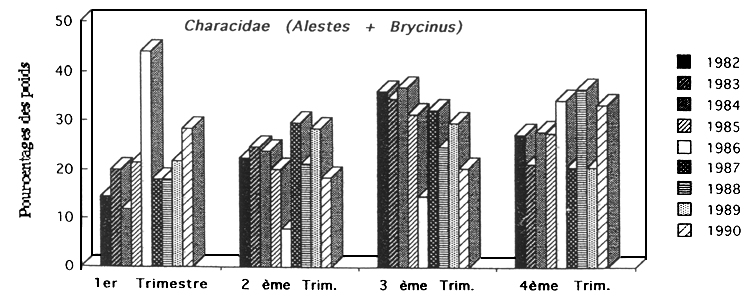
4.2.3.4.Production halieutique du lac de Taabo
Tableau : Aperçu sommaire de la production halieutique du lac de Taabo
| Annees | Production totale | Oreochromis niloticus | Heterotis niloticus | Chrysichthys Spp |
| 1986 | 431 | 171 | 31 | 11 |
| 1987 | ||||
| 1988 | 401 | 96 | 72 | 116 |
| 1989 | 418 | 96 | 98 | 36 |
| 1990 | 397 | 141 | 68 | 58 |
| 1991 | 462 | 155 | 165 | 66 |
| 1992 | 202 | 58 | 136 | 35 |
| 1993 | 328 | 148 | 54 | 72 |
| 1994 | 363 | 139 | 68 | 80 |
| 1995 | 378 | 209 | 64 | 49 |
*Source: Cantonnement piscicole de Taabo (Eaux-et-Forêts)
Les statistiques revèlent que les besoins en poissons de trois départements (Korhogo, Ferké, Boundiali) se chiffrent à 16.800 tonnes. La production locale se chiffrant à 412 tonnes de poissons, n'en représente que 2,5 %. Il est donc impératif que des efforts soutenus soit déployés pour combler le déficit entre la production et la consommation locales.
| ANNEE | KORHOGO | FERKE |
| 1987 | - | 491,694 |
| 1988 | 12,314 | 410,594 |
| 1989 | 36,533 | 378,947 |
| 1990 | 30,543 | 373,288 |
| 1994 | 20,000 | 299,500 |
Cette production est essentiellement fournie par les principales retenues hydro-agricoles que sont les lacs de Morisson, Lokpôhô, Nafoun, Solomougou, Sologo et Gbémou.
La production halieutique des petites retenues agro-pastorales (Sambakaha, Gboyo, Katiali, Korokara, Nabemgué, etc…) est insignifiante.Le régime des pêches sur les petites retenues ne couvrent pas toute l'année. Plusieurs raisons expliquent cela :
- les conflits permanents entre les membres des comités de gestion et les pêcheurs. Ces conflits sont souvent générés par le partage des butins ;
- la dégradation et le non renouvellement des engins de pêche ;
- le retour temporaire des bozos au Mali natal pour s'acquitter de leur devoir champêtre vis-à-vis des parents ;
- l'ampleur et la longueur de la période d'étiage.
La plupart, de ces petites retenues sont exploitées au maximum deux (2) à trois (3) mois (de Mai à Juillet) par un ou deux pêcheurs par retenue. La valorisation des potentialités piscicoles et halieutiques des retenues hydro-agro-pastorales de la Côte d'Ivoire devient une alternative incontournable. Le potentiel offert par les petits plans d'eau est une source supplémentaire importante de poissons pour les communautés rurales.
Depuis la mise en eau du lac, les efforts de pêche déployés (nombre de pêcheurs, nombre d'engins, surfaces pêchables du lac, nombre d'embarcations etc…) ont connu une augmentation régulière d'année en année.
Les informations recueillies auprès des services de pêche ont permis de recenser … pêcheurs sur les lacs de barrages de Côte d'Ivoire. Cet effectif se repartit comme suit :
- … pêcheurs sur le lac de Kossou;
- … pêcheurs sur le lac de Buyo ;
- … pêcheurs sur le lac d'Ayamé ;
- … pêcheurs sur le lac de Taabo ;
- … pêcheurs sur les retenues hydro-agricoles du Nord
a) Cas du lac de Buyo
Le nombre de pêcheurs en activité sur le lac de Buyo est passé de 709 en 1982 à 2.100 pêcheurs en 1990 mais le chiffre le plus important a été observé en 1989 avec 2.954 pêcheurs (tableau 31). Comme l'atteste la figure …, la pêche est à 90%, entre les mains des pêcheurs étrangers en grande majorité de nationalité malienne (Somonos, Bozos, Peuhls, Songhaï, Bambaras etc…)
Tableau 31 : Variations du nombre de pêcheurs
• Dans la zone de Buyo
| ANNEES | |||||||
| 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | ||
| PECHEURS | |||||||
| Ivoiriens | 224 | 230 | 178 | 40 | 68 | 37 | |
| Bozos | 423 | 685 | 705 | 849 | 892 | 586 | |
| TOTAL | 647 | 915 | 883 | 889 | 960 | 623 | |
• Dans la zone de Guessabo
| ANNEES | |||||||
| 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | ||
| PECHEURS | |||||||
| Ivoiriens | 159 | 159 | 143 | 44 | 93 | 47 | |
| Bozos | 841 | 660 | 357 | 621 | 882 | 626 | |
| TOTAL | 1000 | 819 | 511 | 665 | 975 | 973 | |
• Dans la zone de pêche de Guiglo
| ANNEES | |||||||
| 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | ||
| PECHEURS | |||||||
| Ivoiriens | 161 | 161 | 139 | 35 | 130 | 20 | |
| Bozos | 760 | 785 | 756 | 685 | 889 | 784 | |
| TOTAL | 922 | 946 | 895 | 720 | 1019 | 804 | |
• Sur l'ensemble du lac
| ANNEES | |||||||||
| 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | ||
| PECHEURS | |||||||||
| Ivoiriens | 554 | 550 | 460 | 142 | 321 | 104 | 82 | 64 | |
| Bozos | 2015 | 2136 | 1818 | 2108 | 2633 | 1996 | 1381 | 1319 | |
| TOTAL | 2569 | 2686 | 2278 | 2274 | 2954 | 2100 | 1463 | 1383 | |
c) Cas du lac d'Ayamé
Tableau 32 : Effectifs des pêcheurs en activité sur le lac d'Ayamé
| Années | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1995 |
| Nb pêcheurs | 1974 | 1068 | 1056 | 1056 | 376 | 380 | 380 | 385 | 275 | 150 | 140 | 250 |
d) cas du lac de Taabo
Tableau 33: Effectifs des pêcheurs en activité sur le lac de Taabo
| Années | Superficie moyenne (ha) | Ecarts |
| 1983 | 530 | 450 maliens |
| 34 guinéens | ||
| 28 ivoiriens | ||
| 12 sénégalais | ||
| 3 mauritaniens | ||
| 3 nigériens | ||
| 1992 | 225 recensés | Tous maliens |
| 1993 | 293 recensés | 190 maliens |
| 3 ivoiriens | ||
| 1994 | 303 recensés | tous maliens |
| 1995 | 295 recensés | tous maliens |
Trois catégories de pêcheurs ont été identifiées sur les barrages étudiés :
- pêcheurs professionnels ;
- pêcheurs occasionnels ;
- agriculteurs / pêcheurs.
Ce sont pour la grande majorité des étrangers surtout des maliens, connus sous le nom de “Bozos” ainsi que quelques “Burkinabés”. Les nationaux, en particulier les Sénoufos, sont très peu intéressés par la pêche, si bien qu'ils sont rares dans ce secteur d'activité. Il s'agit d'opérateurs qui n'ont d'autre activité que la pêche et dont les revenus financiers sont assurés exclusivement grâce à la capture et à la vente de poissons. Cette catégorie de pêcheurs se rencontrent essentiellement dans les retenueshydro-agricoles : Morisson, Lokpôhô, Nafoun, Solomougou et Sologo). Ce sont des pêcheurs qui ont établi leur habitat dans la localité abritant le barrage. Les pêcheurs professionnels effectuent des migrations d'un lac à un autre, les captures sont fonction du rendement de la pêche.
Ce sont en général des agriculteurs et rarement des éleveurs pour qui la pêche ne constitue pas la seule source de revenus. Ils ne consacrent que 10 à 25 % de leur temps de travail à cette activité. Il s'agit généralement de membres de comités villageois de gestion des barrages. Ils pratiquent la pêche généralement à la fin des travaux champêtres.Leur savoir-faire est rudimentaire. Quelquefois, il s'agit de bozos qui ont été intégrés dans la communauté villageoises et qui ont parfois bénéficié de certains avantages tels l'attribution d'un lopin de terre pour y exercer l'agriculture. Ces derniers se sont intégrés grâce à leur mariage avec une femme du village. Leur activité est partagée entre l'agriculture et la pêche.
Cette catégorie de pêcheurs renferme en général des agents de l'Etat ou travailleurs à la retraite et originaire de la région. Ils pratiquent la pêche de façon occasionnelle, pour subvenir à leurs besoins alimentaires. Il est difficile de quantifier l'importance de leurs captures. Dans cette catégorie, se classent aussi les enfants dont les champs sont à proximité des retenues,
Tableau 33 : Ventilation des pêcheurs par nationalité
| Kossou | Buyo | Taabo | Ayamé | |||||
| Nationalités | Nb | % | Nb | % | Nb | % | Nb | % |
| Maliens | 654 | 83,9 | 1.715 | 92,9 | 287 | 93,8 | 170 | 99,4 |
| Ivoiriens | 102 | 13,1 | 75 | 4,1 | 14 | 4,6 | 1 | 0,6 |
| Ghanéens | 12 | 1.5 | - | - | - | - | - | - |
| Béninois | 1 | 0.1 | 2 | 0,1 | - | - | - | - |
| Togolais | 1 | 0.1 | - | - | - | - | - | - |
| Nigériens | 2 | 0,1 | - | - | - | - | - | - |
| Mauritaniens | 2 | 0,2 | - | - | - | - | - | - |
| Sénégalais | 2 | 0.2 | 11 | 0.6 | - | - | - | - |
| Burkinabés | 3 | 0.3 | 22 | 1.2 | - | - | - | - |
| Guinéens | - | - | 11 | 0.6 | 3 | -1 | - | - |
| Nigérians | - | - | 10 | 0.5 | 2 | 0.7 | - | - |
| TOTAL | 779 | 100 | 1846 | 100 | 306 | 100 | 171 | 100 |
Tableau 34: Ventilation des pêcheurs par ethnie
| Kossou | Buyo | Taabo | Ayamé | |||||
| ETHNIES | Nb | % | Nb | % | Nb | % | Nb | % |
| Bozo | 185 | 23,7 | 459 | 21,2 | 60 | 19,3 | 79 | 46 |
| Malinké | 19 | 2,4 | 72 | 3.3 | 5 | 1,6 | - | |
| Peuhl | 98 | 12,5 | 490 | 22,7 | 42 | 13,5 | 15 | 8,8 |
| Sonrai | 181 | 23,2 | 302 | 14 | 138 | 44,4 | 60 | 35 |
| Bambara | 103 | 13,2 | 246 | 11,4 | 42 | 13,5 | 8 | 4,7 |
| Sarakolé | 12 | 1.5 | 60 | 2,7 | - | - | - | - |
| Dogon | 12 | 1,5 | 52 | 2.4 | - | - | - | - |
| Maraka | 13 | 1,7 | 28 | 1,3 | - | - | 5 | 2,9 |
| Bêla | 31 | 4 | 106 | 4.9 | - | - | - | - |
| Guéré | - | - | 13 | 0.6 | - | - | - | - |
| Ahibé | 11 | 1,4 | - | - | - | - | - | . - |
| Bété | 12 | 31 | 1,4 | - | - | - | - | |
| Baoulé | 76 | 9,7 | - | 0,2 | 14 | 4,5 | - | - |
| Gouro | 16 | 2 | - | - | - | - | - - | |
| Ahizi | 5 | 0.6 | - | - | - | - | .- | - |
| Autresethnies | - | 46 | 2,1 | 5 | 1.6 | - | - | |
| Divers | 19 | 2,3 | 245 | 2,1 | 5 | 1,6 | 4 | 2,3 |
Dans les lacs, les pêcheurs utilisent des techniques et engins de pêches dont la sélectivité est orientée vers des performances de plus en plus meurtrières pour les espèces économiquement intéressantes. Six types d'engins sont utilisés sur les lacs : filets maillants, éperviers sennes, nasses, pièges-bambou et palangres
a)- Captures aux filets maillants
Les filets maillants constituent l'engin le plus utilisé sur les lacs en toutes saisons puisqu'ils fournissent plus de 90 % des captures réalisées. Ce sont des engins individuels (mais les pêcheurs travaillent souvent à deux) utilisés selon la méthode de filet dormant. Ils sont posés dans les eaux proches des rivages, souvent dans les secteurs où la végétation immergée est dense, par des fonds généralement inférieurs à 3 m. On observe en moyenne, par embarcation, 6 filets de 50 à 100 m de long et 1,5 m à 3 m de chute, ce qui représente environ 1000 m2. De 1985 à 1990, les filets de 30 mm et de 40 mm de maille ont été les plus utilisés par les pêcheurs commerçants avec respectivement des fréquences de 34,8 et 30,7 % sur l'ensemble du lac de Buyo.
b)- Captures aux nasses
Trois types de nasses sont utilisés sur les lacs :
- les nasses en grillage métallique qui sont des rectangles grillagés repliés sur eux mêmes, d'environ 1,5 m de long, 1 m de large et 30 cm de haut, avec des mailles de 35 mm. Ces nasses sont utilisées généralement en période des hautes eaux;
- les nasses en bambou tressé sans maille, de forme cylindrique et ayant 1 m de long et 25 à 30 cm de diamètre ;
- les nasses en fil de pêche sur armature de bois qui sont des engins de forme tronconique, de 60 cm de hauteur et 50 cm de diamètre horizontal, avec des mailles de 20 à 30 mm.
On dénombre, en moyenne une vingtaine de nasses par pêcheur. Elles sont utilisées surtout en période de montée des eaux. Elles sont immergées en permanence, accrochées aux troncs d'arbre ce qui permet d'exploiter les endroits inaccessibles à d' autres engins de pêche et de conserver les poissons vivants. Elles capturent surtout les Chrysichthys et dans une moindre proportion les Tilapia zillii, les Hemichromis.
c) Captures aux pièges-bambou
Les pièges-bambou sont des morceaux de bambou de Chine ouverts complètement à une extrémité et percés d'un petit trou à l'autre. Long d'un mètre et ayant un diamètre de 10 cm, le bambou est pendu verticalement, la grosse ouverture vers le dessus. Le piège-bambou est un engin très sélectif vis-à-vis des femelles ovigères de Chrysichthys qui s'y coincent en cherchant un site de ponte. On dénombre en moyenne environ 50 pièges-bambou par pêcheur.
d) Captures aux éperviers.
Les éperviers sont constitues par une nappe plate circulaire munie de plomb sur la périphérie. Ceux utilisés sur le lac de Buyo ont 7 à 8 m de diamètre d'ouverture et des mailles variant de 20 à 60 mm. Les jets d'éperviers sont habituellement effectués très tôt le matin et à la tombée de la nuit Ce sont des engins qui capturent en majorité des Heterotis et des Tilapia dans le lit des fleuves originels. En moyenne on dénombre 0,1 épervier par pêcheur.
e) Captures à la senne de rivage
Les sennes de rivage sont des engins collectifs manipulés par des équipes de 5 à 6 personnes. La pêche à la senne est une pratique relativement récente qui n'a fait son apparition sur les lacs ivoiriens qu'en 1988 . Ces sennes n'ont pas de poche véritable et ont en général, une longueur de 200 m. Les mailles de la partie centrale sont de l'ordre de 35 mm, noeud à noeud.
f) Captures aux palangres
Les palangres sont des engins dormants mouillés sur le fond ou entre deux eaux. Un palangre se compose d'une ligne principale, d'avançons et d'hameçons. Les avançons, parfois métalliques, sont des fils supportant les hameçons et rattachés au bas de la ligne par une boucle. Les palangres capturent préférentiellement les Heterobranchus et les Clarias mais prennent parfois des Tilapia zillii, des Characidae et des Mormyridae. Les captures réalisées avec les palangres repré-sentent un pourcentage négligeable de la distribution pondérale des captures totales.
Les proportions des engins de pêche utilisés par les pêcheurs contrôlés au débarcadères d'Ayamé sont consignées dans les tableaux suivants :
Tableau 35 : Taux d'utilisation des différents engins de pêche à Ayamé
| ANNEES | Filets maillants | Eperviers | Nasses | Lignes |
| 1979 | 97,5 | 0,1 | 1,8 | 0,6 |
| 1980 | 96,8 | 0 | 2,1 | 1.1 |
| 1981 | 93,6 | 3,4 | 2,5 | 0,5 |
| 1982 | 98 | 1,8 | 0,2 | 0,0 |
| 1983 | 87,2 | 9,5 | 3,3 | 0,0 |
| 1984 | 85,6 | 11.3 | 3,1 | 0,0 |
| 1985 | 77,8 | 14,2 | 3,0 | 0,0 |
| 1986 | 87,1 | 10,7 | 1.3 | 0,8 |
| 1987 | 80,1 | 16,3 | 2.3 | 1.3 |
| 1988 | 78,9 | 9.9 | 10 | 1.2 |
| 1989 | 81 | 14,5 | 3.5 | 0.9 |
Tableau 36 : Occurence moyenne d'utilisation des différents types d'engins de pêche en activité sur les lacs
| Lac | Ayamé | Kossou | Taabo | Buyo |
| Sennes | 0,12 | 0,23 | 0,28 | |
| Filets < 20 mm | 0.2 | 0,01 | 0,02 | |
| Filets > 20 mm | 0,78 | 1,07 | 1.93 | 2,02 |
| Nasses < 20 mm | 0,3 | 0,9 | 3,56 | 2,8 |
| Nasses > 20 mm | 3,20 | - | 1.61 | 1,74 |
| Eperviers | 1.17 | 0,13 | 0,14 | 0,15 |
| Palangres | 0,02 | 0,08 | 0,04 | 0,06 |
| Bambous | 80 | 28 | - | 36 |
Il ressort de l'examen de ces tableaux que les engins de pêche utilisés sur les lacs d'Ayamé, de Kossou et de Buyo sont le filet maillant, l'épervier, la nasse, la ligne, la palangre et les pièges-bambou.
• Les filets maillants sont les engins de pêche les plus couramment utilisés. Ces filets sont calés en surface et relevés matin et soir. Ils sont posés parallèlement aux berges, surtout si les nappes sont courtes ou bien au milieu de la retenue en travers de l'ancien cours de la Bia. La portion des captures par espèce est sensiblement la même pour les filets maillants et l'ensemble des engins de pêche.
• Les nasses capturent surtout des Chrysichthys et dans une proportion moindre des Tilapia zillii, ainsi que des prédateurs sans doute attirés par les autres poissons. Les nasses, accrochées aux troncs d'arbres sont immergées en permanence. Elles sont fabriquées par les pêcheurs, en ligne, en grillage ou en bambou et elles permettent d'exploiter les endroits inaccessibles aux autres engins de pêche, en conservant le poisson vivant.
• Les éperviers sont des engins qui capturent particulièrement les Heterotis niloticus.
• Les lignes sont utilisées pour capturer les Heterobranchus, mais elles prennent parfois des Tilapia, des Brycinus et des Mormyridae. Elles représentent un pourcentage négligeable de la distribution pondérale des captures selon les engins.
• Le piège-bambou est un engin très sélectif vis-à-vis des femelles ovigères des Chrysichthys qui s'y coincent en cherchant un site de ponte. On dénombre en moyenne 50 pièges-bambou pour pêcher.
• Les palangres capturant surtout des poissons de fond et étant dès lors complémentaires aux filets, elles constituent un moyen secondaire idéal pour exploiter plus complètement les populations piscicoles d'un lac. Les palangres pourraient remplacer les filets maillants dans les périodes de pleine lune. Leur utilisation est largement repandue dans les pêcheries continentales et fournit une quantité considérable de poissons. L'appât joue une rôle très important en ce qui concerne la composition spécifique des prises. Hemichromis fasciatus , Hepsetus odoe et Para channaobscura ne sont capturées qu'avec du poisson frais alors que les Chrysichthys et Malapterurus electricus sont presque exclusivement pris aux hameçons appâtés avec des escargots. Le savon à l'huile de palme n'attire que les silures (Heterobranchus spp et Clarias spp). A par quelques espèces ayant une bouche relativement petite (Hemichromis fasciatus, Chrysichthys spp) et qui sont prises surtout par des petits hameçons, la taille de ceux-ci semble avoir peu d'importance pour la composition spécifique.
La composition des prises au palangre est complémentaire à celle des filets maillants. Les espèces les plus importantes pour les palangres sont les poissons de fond, dorso-ventralement aplatis qui sont très rares dans les filets maillants : moins de 1 % du poids pour Clarias anguillaris, Malapterurus electricus et Parachanna obscurci ensemble (Roest, comm. pers.). Hepsetus odoe est également rare dans les prises aux filets.
Les efforts de pêche estimés par le nombre d'engins utilisés, évoluent différemment selon la nature de ceux-ci. Mais à priori, on peut constater une corrélation positive entre la production totale et les efforts de pêche. En général, les filets maillants pêchent plus de 98 % de la production de Oreochromis niloticus. L'effet de pêche “filets” s'intensifie avec l'augmentation du niveau de l'eau dans la retenue et l'inondation des haut-fonds. Un effort de pêche supplémentaire est fourni par les pêcheurs saisonniers (pêcheurs étrangers et pêcheurs planteurs). Les pêcheurs exploitent intensement les populations d'Oreochromis niloticus qui viennent s'installer dans les zones d'eau peu profondes favorables au frai. Ces stocks étant très vite exploités, les efforts de pêche diminuent ensuite.
L'effort de pêche “épervier” augmente avec l'accroissement des surfaces noyées, l'effort maximum correspond donc au maximum de précipitation.
L'étalement de l'effort de pêche “épervier” est lié au comportement biologique d'Heterotis niloticus qui se reproduit pendant la montée des eaux dès que les zones de végétation assez denses sont accessibles. L'échelonnement des pontes et par là, même l'étalement de la production est fonction du déplacement des frayères, Il faut, en effet, 30 à 50 cm d'eau au milieu du nid pour la poste (Daget, 1957). Les Heterotis niloticus sont repérés par les pêcheurs au moment où ils viennent prendre de l'air en surface