Table des matières
- ![]() Précédente - Suivante
Précédente - Suivante![]()
LES TECHNIQUES CULTURALES TRADITIONNELLES
Dans la zone à moins de 400 mm de pluie, on constate une nette rupture avec les conditions des régions soudaniennes. Les pluies sont plus erratiques et limitées dans l'espace. Alors qu'au nord du Sahara, en milieu méditerranéen où les pluies tombent en saison froide, il existe plusieurs systèmes pour collecter les eaux de pluie ou de ruissellement, pour faire pousser des arbres et des céréales au milieu de larges impluvium, les stratégies de gestion des eaux dans la zone tropicale sahélienne où les pluies tombent en période chaude, sont peu nombreuses et peu apparentes. En réalité, elles s'appuient sur le choix des cultures en fonction des sols (mil sur sol sableux, sorgho sur sols limoneux et dans les bas-fonds et jardins irrigués autour des mares) et sur l'adaptation aux opportunités des orages (très faible travail du sol mais semis directs, répétés, très peu coûteux en graines (3 kg/ha) et en travail (9 heures), sur de grandes surfaces semées quitte à en abandonner une grande partie lors du sarclage.
FIGURE 64 : Schéma d'aménagement d'un terroir sahélien (P < 400 mm): exemple d'un système agropastoral où l'agriculture intensive est limitée à la vallée (valley farming)
Impluvium et parcours | Cultures en sec aléatoires sous un parc de vieux arbres | Cultures intensives irrigués ou de décrue | |
dunes ou placages sableux | glacis limoneux | bordure de vallée ou de mare |
Figure
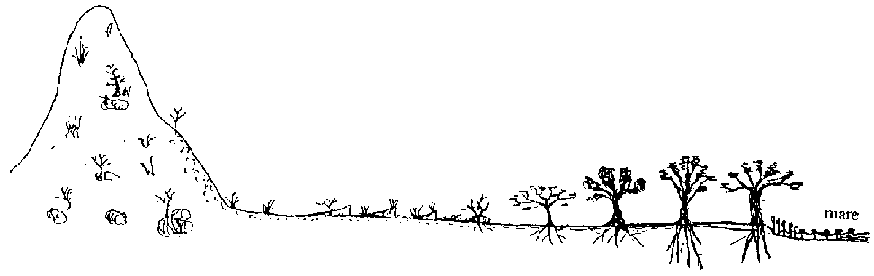
lithosols | sols bruns rouges | sols hydromorphes |
semi-arides | assez fertiles |
Sols pauvres: | carences en N et P. pauvres en matières organiques, risque de salinisation |
Sols fragiles: | croûtes de battance et d'érosion |
perméables s'ils sont couverts d'une nappe de sable | |
vite battants sur les limons |
Risques: | battance des sols ® décapage | battance, | hydromorphie, salure |
érosion éolienne sur sables | dégradation des | en surface | |
M.O. et ravinement |
Améliorations
- Grand impluvium
- Parcours extensifs
- 1/2 lunes ou zaï pour implanter du mil et des
arbustes
- Un peu de culture de mil sur les placages sableux
- Capter le ruissellement pour créer de petites mares pour abreuver le bétail
- Fixer les placages sableux à l'aide d'arbustes pour réduire les risques de dégâts aux cultures voisines par les nappes de sables éolisés
- Irrigation complémentaire grâce à la nappe par les eaux de ruissellement Grands Acacia enracinés jusqu'à la nappe
- Rotations mil- arachide ou niébé | Jardins fruitiers + potagers intensifs irriguées |
- Si possible, haies : Acacia d'euphorbia balsamifera ou de graminées pérennes: Andropogon | Cultures fourragères dans et autour des mares |
Enfin, la survie est souvent basée sur la migration à faible distance en vue de récolter le fonio sauvage ou les bulbes de nénuphar. Les habitations sont sur les champs cultivés, de novembre au mois d'août près des greniers et du lieu de traite des animaux. La migration du troupeau sur un pâturage occasionnel est organisée systématiquement (Milleville, 1982).
Mais cette région vit essentiellement du pâturage extensif des troupeaux qui migrent en fonction des opportunités. L'usage comme combustible des résidus de culture et même des déjections animales montre à quel point cette zone manque de bois.
LE DIAGNOSTIC DU MILIEU
Les pluies varient de 400 à moins de 150 mm; les pluies mensuelles maximum sont de l'ordre de 175, le drainage calculé est nul, l'indice d'érosivité est inférieur à 200, la pluie journalière de fréquence 1/10 est égale à 80 et la densité de population baisse brutalement à moins de 10 hab/km2 .
Le paysage est fait de collines dioritiques suivies d'un glacis sableux et ensuite d'un long glacis limoneux aboutissant aux alentours de la mare. Sur le glacis sableux, se sont formées des petites dunes autour des touffes d'herbe et des buissons. Sur les glacis limoneux, surtout là où la nappe n'est pas trop lointaine, persiste encore quelques vieux Faidherbia albida et autres épineux. Les sols sont lithomorphes sur les montagnes, sableux sur les dunes et sont des sols brun-rouge subarides aux alentours des marais. Les techniques traditionnelles consistent à semer à plat le mil sur les sables, les sorgho sur les bas-fonds argileux, et d'utiliser les versants comme pâturages extensifs. Enfin, dans les bas-fonds se développent des jardins et un certain nombre de cultures de décrue tout autour de la mare.
LES RISQUES
Sur la zone sableuse, les risques sont des risques d'érosion éolienne essentiellement, avec dégradation de la végétation à la fois par le surpâturage et par l'érosion éolienne. Sur le glacis limoneux, sous l'effet de la battance, se développe un ruissellement extrêmement abondant qui évolue en petites ravines.
LES PROPOSITIONS D'AMELIORATIONS (figure 64)
Le milieu étant extrêmement fragile, il est périlleux de conseiller le développement d'un système agro-pastoral au rythme de la croissance démographique. En réalité, le développement semble bloqué aujourd'hui car presque toutes les terres cultivables sont déjà cultivées. Les jachères disparaissant, les sols s'épuisent et le coût des intrants (fertilisation minérale et variétés à cycle court) n'est rentable que les années où les pluies sont abondantes et bien réparties (Milleville, 1982). On pourrait cependant expérimenter à l'échelle d'un terroir comme à Ségué (nord du Yatenga):
- l'installation de haies vives ou d'épineux fourragers sur les zones sableuses (Balanites, Acacias albida, Acacias nilotica, etc...),
- des impluviums collectant les eaux pour des petits champs billonnés sur glacis limoneux,
- l'aménagement agro-forestier des bas-fonds (cordons de pierres, haies vives, arbres fourragers et fruitiers),
- l'aménagement des bordures de mares en vue d'une culture intensive diversifiée (fourrage pour la production laitière, céréales, légumes et quelques fruitiers).
TABLEAU 39 : Variabilité des conditions écologiques sur un transect bioclimatique d'Afrique occidentale - Diversité des propositions d'amélioration (d'après Roose, 1992)
Zone écologique | Guinéenne forestière | Sud soudanienne | Nord soudanienne | Sud sahélienne | Nord sahélienne |
Pluies ann. moyennes | 2100 mm | 1350 mm | 900 mm | 725 mm | 535 mm |
Diagnostic des risques |
|
|
|
|
|
Sols du versant | ferrallitiques très désaturés | - ferrallitiques désaturés gravillonnaires | - ferrugineux lessivés SA gravillonnaires | - ferrugineux lessivés SA gravillonnaires | - ferrugineux peu lessivés sableux sur dunes |
Végétation | Forêt ombrophile dense humide + Panicum, etc | Savane arborée Daniella, Parkia, Butyrospermum + Andropogon + divers | Savane arborée Parkia, Butyrospermum + épineux + Andropogon + divers | Savane arbustive à Combretum, | Steppe ou bush Boabab, Acacia, Balanites, Ziziphus graminées annuelles |
Agrosystèmes | Cover farming = couverture du sol infiltration totale | Drainage farming = drainage des excés durant les 2 mois les + humides | Rainfed farming = infiltration totale des pluies | Runoff farming capture pluie + ruissellement | Valley farming. Concentration de l'eau et des cultures dans les vallées |
Densité des populations (hab/km2 ) | 20 à 40 | 30 à 100 | 30 à 50 | 70 à > 100 | 10 habitants/km2 |
Techniques traditionnelles | - manioc + maïs + condiments associés sur petites buttes | - ignames sur grosses buttes | - culture à plat + 1 sarclage + 1 buttage sorgho/coton ou mil/arachide/niebe | - semis direct a plat après brûlis puis 1 sarclage et 1 buttage: sorgho ou mil/arachide/niebe | - semis direct à plat + 1 sarclage débuttage |
Aménagements proposés | GCES | CES 11964-68) | GCES 1985-91 | DRS du GERES 1960-65 | GCES |
Cependant, il est clair que la production agricole est limitée aux bas-fonds et que l'élevage avec un nomadisme à faible distance est mieux adapté à ce milieu sahélien très fragile que la culture.
CONCLUSIONS Du survol de cette séquence bioclimatique, on peut conclure que parallèlement à l'évolution des techniques culturales en fonction du bilan hydrique, il faut adapter le mode de gestion des eaux au niveau des structures antiérosives (voir tableau 39). On comprend mieux de ce fait, l'une des raisons des échecs des multiples projets de CES-DRS qui s'acharnent à appliquer l'unique modèle développé par Bennet à une autre époque, dans des conditions de climat tempéré et de culture motorisée intensive. On comprend aussi les paysans traditionnels qui, non seulement n'entretiennent pas les aménagements imposés, mais les détruisent lorsqu'ils constatent qu'ils sont peu adaptés à la situation de leurs cultures. L'analyse des stratégies traditionnelles, parallèlement au bilan hydrique mensuel, pourrait orienter les projets futurs de gestion de terroir qui devraient s'attacher à les améliorer avec la connivence des fermiers et des éleveurs. C'est une aventure de recherches et de développement de longue haleine où les aspects humains sont aussi importants que les aspects techniques. Il est donc nécessaire de prévoir des équipes multidisciplinaires de suivi et d'évaluation de ces projets. |
Chapitre 10 : Evolution du bocage Bamiléké
Problématique
Diagnostic: des milieux relativement fragiles
Des techniques traditionnelles efficaces
Les risques
Quelques propositions d'améliorations
Jean-Marie Fotsing
Chargé de cours en Géographie à l'Université
de Yaoundé, Cameroun
EXEMPLE D'ADAPTATION TRADITIONNELLE A UNE FORTE DEMOGRAPHIE
Situés en Afrique centrale, entre le 5e et le 6e degré de latitude nord, les plateaux bamilékés occupent 6196 km2 au sud des hautes terres de l'Ouest-Cameroun (figure 65). Avec une densité moyenne de 168 hab/km2 atteignant localement 600 hab/km2 , c'est une des rares régions tropicales d'agriculture pluviale traditionnelle supportant de telles charges démographiques. Un diagnostic des techniques d'exploitation des terres montre que celles-ci sont relativement efficaces du point de vue du maintien de la fertilité et de la lutte antiérosive. Cependant, les transformations en cours dans la région aboutissent d'une part, à la simplification des aménagements dans les zones anciennement occupées et d'autre part, à l'extensification des méthodes d'exploitation du sol dans les zones récemment mises en valeur. Ainsi, la forte pression démographique, l'augmentation du nombre de cases et les exigences socio-économiques actuelles peuvent avoir des conséquences néfastes sur un environnement pour le moins fragile. Dès lors, les précipitations relativement peu agressives, ont de plus en plus tendance à se concentrer en surface et, les ruissellements qui s'en suivent menacent les terres agricoles situées sur des terrains pentus. Que faire? Peut-on imaginer une montagne dense, productive et stable? La réussite mitigée du Projet de Développement Rural de la Province de l'Ouest, qui proposait entre autres, le creusement de fossés antiérosifs, l'aménagement des versants en gradins et la fertilisation minérale, nous conduit à envisager des solutions essentiellement fondées sur les savoir-faire locaux dans ce milieu aux potentialités agricoles élevées.
Diagnostic: des milieux relativement fragiles
UN RELIEF VALLONNE MARQUE PAR DES PENTES FORTES
Le pays Bamiléké est un haut plateau d'environ 1450 m d'altitude moyenne. Il se décompose en trois unités orographiques majeures qui se succèdent de 700 à 2740 m d'altitude (figure 65).
FIGURE 65 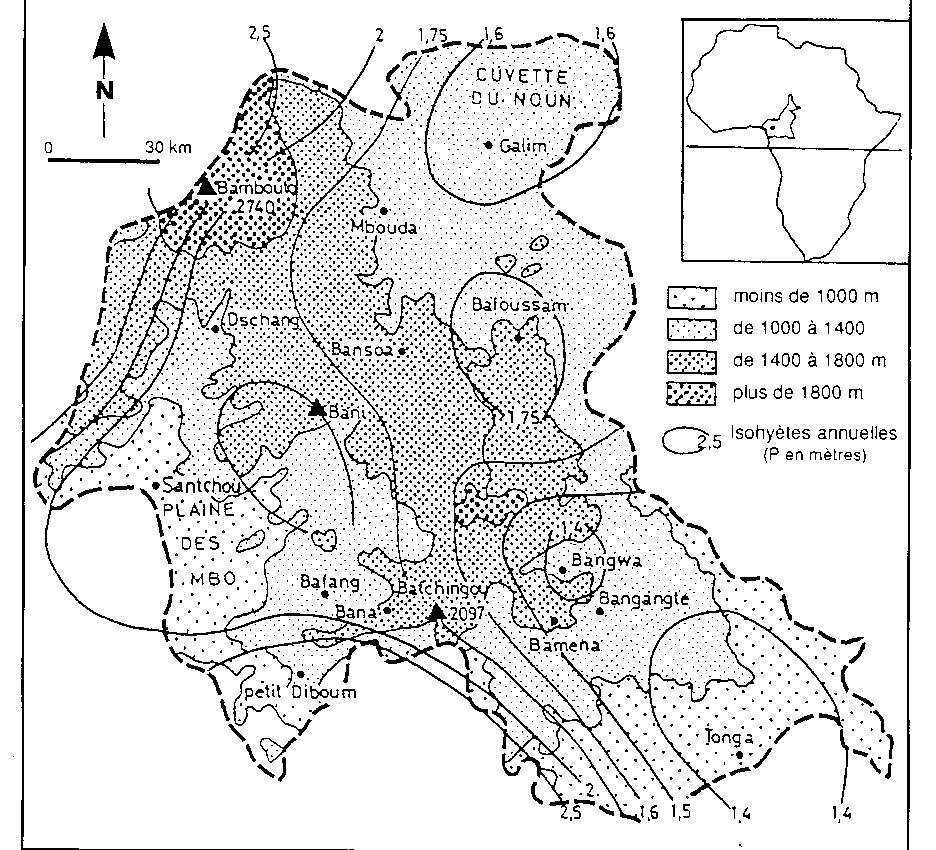
Jusqu'à 1100 m d'altitude, les plaines en situation périphérique (Noun à l'est et Mbo au sud-ouest), occupent près de 20 % des superficies. Leur platitude est interrompue par de petites collines aux versants à pentes faibles (moins de 12 %).
Entre 1100 et 1600 m, les plateaux forment l'ossature principale du relief sur plus de 70 % du territoire. On y distingue deux sous ensembles:
- le plateau granito-gneissique au sud, avec des reliefs polyconvexes ou en demi-oranges sur lesquels affleurent par endroits des boules de granites,
- le plateau basaltique vers le nord, avec une topographie plus calme où les interfluves en croupes surbaissées, arrondies ou allongées sont séparés par des vallées étroites. Les pentes supérieures à 25 % et celles comprises entre 12 et 25 % y dominent.
Au-dessus de 1600 m, les montagnes (moins de 15 % du territoire), présentent une topographie plus heurtée avec 75 % des surfaces situées sur plus de 25 % de pente. Il s'agit d'une part, de petits massifs granitiques culminant à moins de 2100 m vers le sud, et d'autre part, de la chaîne volcanique des Bamboutos au nord-ouest qui, par gradins successifs, porte les altitudes jusqu'à 2740 m (point culminant de la région).
DES PLUIES PEU AGRESSIVES SUR DES SOLS VULNERABLES
Le climat est du type subéquatorial de mousson à dominante humide et fraîche, à une saison des pluies (mi-mars à mi-novembre). Les précipitations annuelles sont partout supérieures à 1400 mm (Bangangté: 1457; Bafang: 1731; Bafoussam: 1796; Santchou: 1727; Dschang: 1919; Baranka: 2500). Les pluies diminuent grossièrement d'ouest en est mais aussi du sud au nord en fonction de l'altitude. Les hauteurs d'eau maximales sont enregistrées en août-septembre. A Bafoussam par exemple, ils atteignent 90 à 116 mm en mars-avril-mai et 118 mm en août. Cependant, les intensités horaires sont faibles (entre 15 à 40 mm/h). Les températures sont raffraichies par l'altitude (à Bafoussam les maxima se situent entre 23 et 27°C).
Les sols se classent en trois groupes (Segalen, 1967; Champaud, 1973):
- les sols ferrallitiques dérivés de basaltes sont les plus répandus. Leurs propriétés physiques et hydriques sont très favorables: grande épaisseur, porosité élevée, friabilité et absence de cailloux, forte teneur en argile et perméabilité de surface. Les sols ferrallitiques indurés portent par endroit des affleurements de cuirasses.
- les sols peu évolués proviennent des roches volcaniques meubles basiques (cendres, lapillis). Ils sont très riches en matières organiques, azote et bases échangeables et très perméables.
- les sols hydromorphes - sableux et carencés sur granite, tourbeux sur basalte et alluvions - occupent les fonds marécageux. Ils sont relativement peu fertiles mais la présence d'eau, la platitude et les teneurs élevées en matières organiques, en font de bonnes terres agricoles.
La texture des sols est très diverse avec des taux de limon de 10 à 30 % et d'argile de 10 à 70 %. Cependant, quelle que soit leur nature, les sols présentent des nuances locales suivant la position sur la toposéquence. D'une manière générale, ils sont plus épais, moins grossiers et plus fertiles sur les bas de versants que sur les parties hautes. Ces particularités locales sont mises en évidence dans l'exploitation et l'aménagement traditionnels de l'espace agraire.
UNE PRESSION DEMOGRAPHIQUE FORTE MAIS VARIABLE SUIVANT LE SUBSTRAT GEOLOGIQUE (figure 66)
Le pays Bamiléké est une région d'occupation humaine ancienne et de forte pression démographique. Sa densité moyenne de 168 hab/km2 (1987), n'a guère de signification particulière. Les densités sur basalte sont partout supérieures à 200 hab/km2 , et dans certains secteurs, elles avoisinent et dépassent 1000 hab/km2 (Ducret & Fotsing, 1987). En dehors de la zone basaltique, elles ne dépassent qu'exceptionnellement 150 hab/km2 (les plus faibles densités se trouvent dans les zones alluviales et sur les massifs montagneux).
FIGURE 66 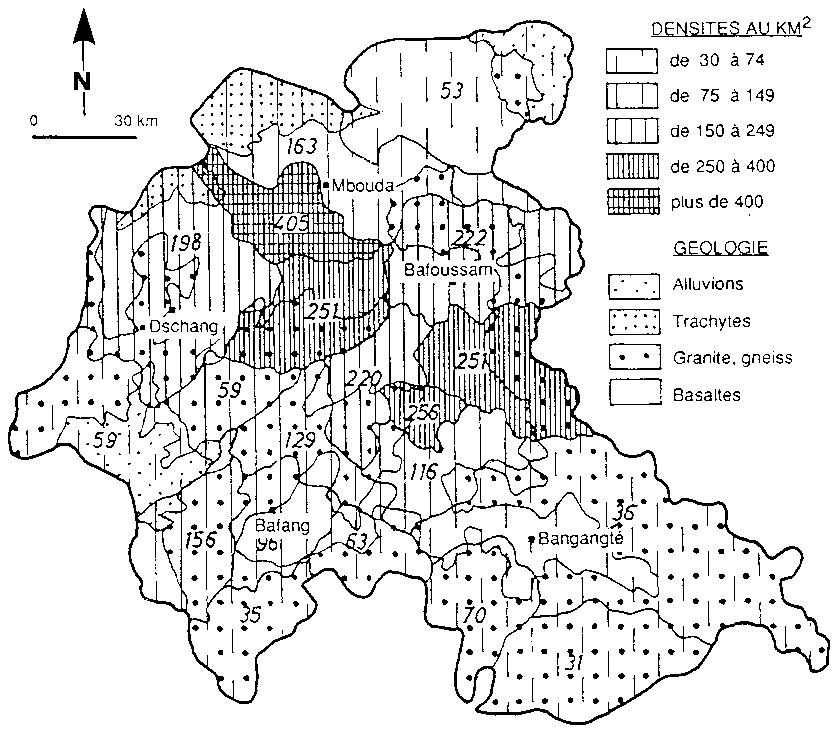
La forte pression démographique est accentuée par la dispersion de l'habitat et le système d'héritage qui lègue la totalité du patrimoine foncier familial à l'unique héritier mâle. Les fils non-héritiers devenant de facto de nouveaux fondateurs de lignage, doivent trouver ailleurs des terres pour s'installer. Avec des taux de croissance annuelle de 3,2 %, la pression foncière ne cesse de s'accentuer malgré un exode massif vers les villes.